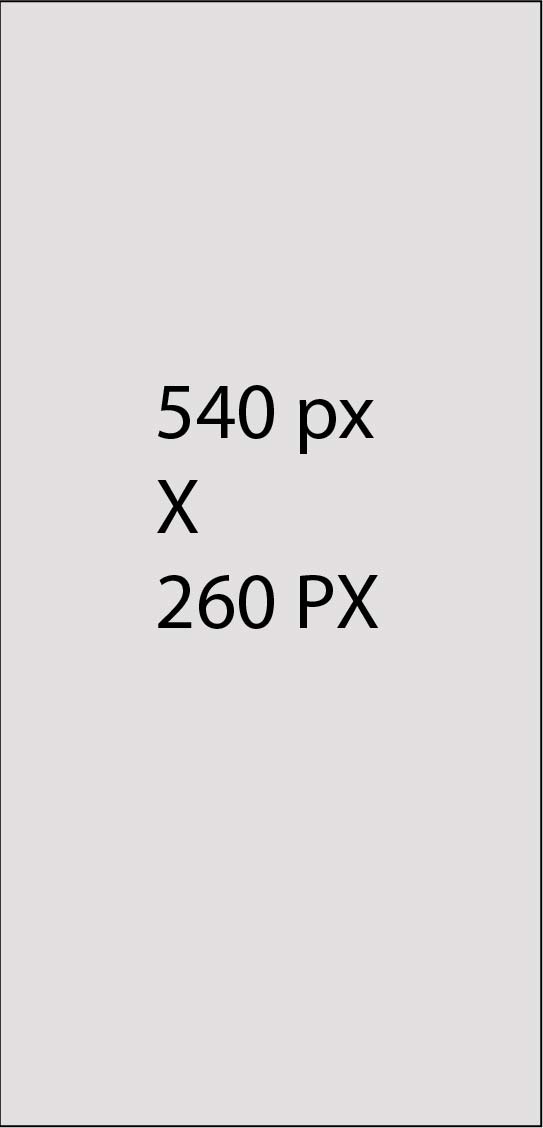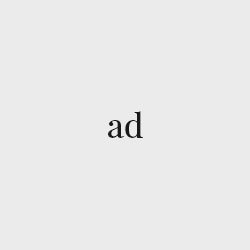Mauvais signe. L’évolution de la pauvreté au Liban est inquiétante. Elle a plus que triplé pendant les dix dernières années, pour atteindre désormais 44% de la population, selon un rapport de la Banque mondiale (BM) publié jeudi dernier. Ce dernier détaille les catégories et les zones les plus touchées par l’affaiblissement de l’économie libanaise.
Menée auprès des ménages dans les gouvernorats d’Akkar, Beyrouth, la Békaa, le Liban-Nord et une grande partie du Mont-Liban, le rapport révèle qu’en 2022, un Libanais sur trois dans ces régions était frappé par la pauvreté, avertit le rapport. Ce dernier sonne ainsi l’urgence de renforcer les filets de sécurité sociale et de créer des emplois. Finalité : réduire la pauvreté et combattre les inégalités croissantes. Intitulé « Évaluation de la pauvreté et de l’équité au Liban 2024: surmonter une crise prolongée », le rapport s’est penché sur l’état actuel de la pauvreté et des inégalités dans le pays. Il met en évidence l’impact de la crise économique et financière sur les ménages et ses effets sur la dynamique du marché du travail. Le rapport révèle une augmentation significative de la pauvreté, passant de 12% en 2012 à 44% en 2022 dans les zones étudiées, et souligne que cette pauvreté est inégalement répartie à travers le pays. Ainsi, dans le nord du Liban, le taux de pauvreté atteint 70% dans le Akkar, où la majorité des habitants travaillent dans l’agriculture et la construction. En outre, non seulement la proportion de Libanais pauvres a triplé pour atteindre 33% par rapport à il y a dix ans, mais ces individus sont également tombés plus profondément dans la pauvreté, avec un écart de pauvreté passant de 3% en 2012 à 9,4 % en 2022. Parallèlement, les inégalités de revenus parmi les Libanais semblent s’accentuer.
PAS ENCORE LE BOUT DU TUNNEL
La crise économique et financière prolongée a contraint les ménages à adopter diverses stratégies d’adaptation, notamment en réduisant leur consommation alimentaire et leurs dépenses non alimentaires, ainsi qu’en réduisant leurs dépenses de santé, avec de graves conséquences probables à long terme. Pour mieux refléter ces changements dans le comportement des ménages, le rapport adopte un nouveau seuil de pauvreté non officiel élaboré pour 2022. Le seuil de pauvreté national de 2012 ne reflète plus les modes de consommation ni les conditions actuelles auxquelles sont confrontés les ménages au Liban.
Le même rapport a ajouté que les envois de fonds de l’étranger sont devenus un tampon économique essentiel, passant d’une moyenne de 13% du PIB entre 2012 et 2019 à environ 30% en 2022, en partie à cause de l’effet dénominateur. En termes nominaux, ces envois de fonds ont augmenté de 20% entre 2021 et 2022.
«La crise actuelle au Liban exige de toute urgence un suivi plus rigoureux de l’évolution du bien-être des ménages afin d’élaborer et d’adopter des politiques appropriées», a assuré Jean-Christophe Carret, directeur des opérations de la Banque mondiale pour le département Moyen-Orient, dans un communiqué de presse diffusé en marge de la publication du rapport.
«L’évaluation de la pauvreté et de l’équité souligne la nécessité cruciale d’améliorer le ciblage des pauvres et d’élargir la couverture et l’étendue des programmes d’assistance sociale pour garantir l’accès des ménages dans le besoin aux ressources essentielles, notamment la nourriture, les soins de santé et l’éducation.
Le rapport révèle également que les ménages syriens ont été durement touchés par la crise. Près de neuf Syriens sur dix vivaient sous le seuil de pauvreté en 2022, avec 45 % des familles syriennes pauvres ayant des scores de consommation alimentaire en dessous du seuil acceptable. La plupart des Syriens en âge de travailler occupent des emplois informels, peu rémunérés et plus précaires, ce qui aggrave leur appauvrissement et leur insécurité alimentaire.
Le rapport préconise une série d’interventions visant à renforcer la résilience des ménages et leur capacité à surmonter la crise prolongée. Il souligne que les filets de sécurité sociale resteront essentiels pour aider les ménages à répondre à leurs besoins fondamentaux à l’avenir. Des réformes macrobudgétaires globales seront nécessaires pour maintenir la stabilité des prix et créer un espace budgétaire pour les dépenses sociales.
Investir dans le capital humain est également crucial pour renforcer la résilience des ménages. Cela implique de garantir et d’élargir l’accès à une éducation de qualité et à des soins de santé abordables. Rendre les transports publics plus accessibles et moins coûteux facilitera également l’accès aux écoles, aux services de santé et à l’emploi.
Autant d’indicateurs qui traduisent la situation complexe dans laquelle se trouve le Liban dont l’instabilité politique n’est pas pour augurer une sortie de crise dans l’immédiat.