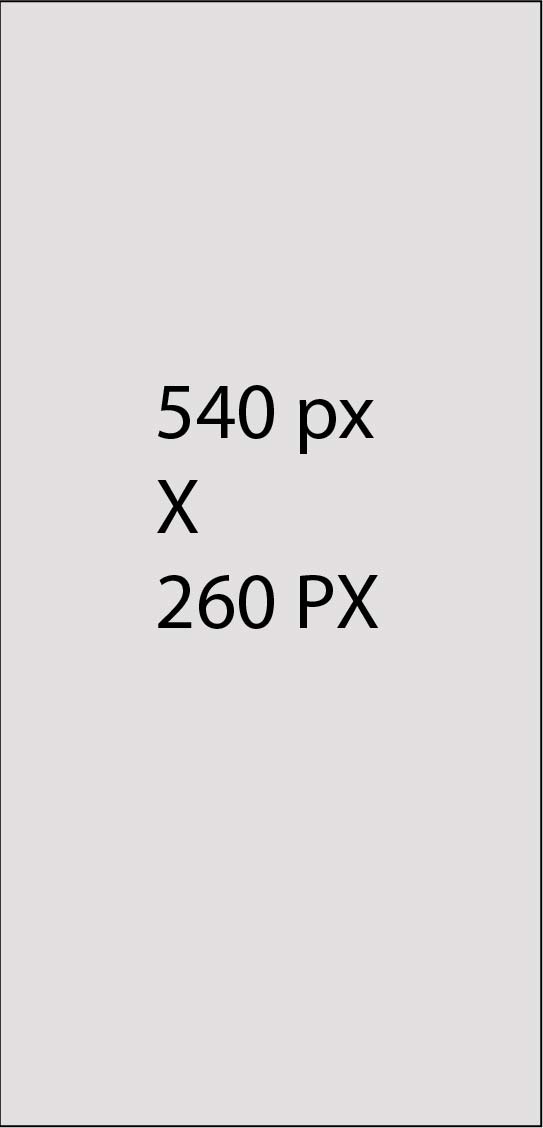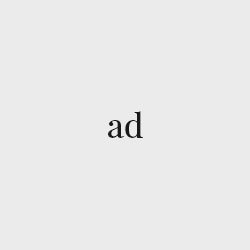Dans cet entretien, le Dr Nabila Hamedi-Siad, enseignante des sciences biologiques et agronomiques à l’Université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, revient en détail sur la récente loi sur l’environnement.
Entretien réalisé par : Larbi Ameziane
Quel est l’impact concret de la responsabilité élargie des producteurs sur la réduction des déchets et le développement de l’économie circulaire en Algérie ?
C’est une avancée considérable, d’abord pour la politique de gestion des déchets en Algérie, mais aussi un levier essentiel pour une économie circulaire et respectueuse de l’environnement. Selon ce principe, les producteurs, c’est-à-dire les personnes qui fabriquent ou mettent sur le marché national certains produits, peuvent être rendus responsables du financement ou de l’organisation de la prévention et de la gestion des déchets issus de leurs produits en fin de vie. C’est le concept du pollueur-payeur, déjà consacré par l’article 3 de la loi 03-10 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable. Plus un produit est polluant, plus le coût lié à sa fin de vie est élevé pour le producteur. En application de ce principe, les filières à responsabilité élargie des producteurs imposent à ces derniers de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus des produits qu’ils mettent sur le marché. L’objectif principal de ce concept est de développer une méthode d’application basée sur la responsabilité élargie des producteurs, c’est-à-dire que ces derniers sont tenus d’assurer la récupération et la valorisation de leurs produits en fin de vie, tout en respectant les lois en vigueur et en minimisant leur impact sur l’environnement. La méthode proposée doit respecter la hiérarchie consacrée à l’article 2 de la nouvelle loi, qui établit la priorité de la préparation à la réutilisation. Les avantages de ce concept sont nombreux, notamment en ce qui concerne la réduction de la quantité de déchets enfouis dans les CET. L’obligation pour les producteurs de réutiliser et de recycler leurs produits ainsi que leurs composantes constitue un incitatif fort à limiter l’utilisation de substances toxiques. Elle permet également une utilisation plus rationnelle des matières premières et une gestion optimisée des ressources en général.
Comment la responsabilité partagée et les éco-organismes peuvent-ils améliorer l’efficacité de la gestion des déchets en Algérie ?
De plus, cela encourage l’efficacité et la compétitivité dans les procédés de fabrication puisque la responsabilité est partagée. Cela améliore également les relations entre les communes, qui deviennent des partenaires potentiels avec des rôles et des responsabilités multiples, notamment en matière de récupération, de sensibilisation au tri sélectif et d’information. Pour s’acquitter de leurs obligations, les producteurs, selon l’article 7 de la loi 25-02, peuvent mettre en place des structures collectives à but non lucratif, les éco-organismes. Selon l’article 3, il s’agit d’un modèle contributif ou financier, dans lequel ces organismes récoltent les éco-contributions auprès des producteurs afin de prendre en charge la gestion des déchets issus de leurs produits. L’article 7 bis 1 précise que les modalités de ces éco-contributions seront fixées par voie réglementaire. On peut, cependant, déjà imaginer que ces contributions seront redistribuées aux communes ou à d’autres opérateurs capables d’assurer la collecte et le tri des déchets. Ce modèle opérationnel permet ainsi de récolter les éco-contributions des producteurs et d’utiliser ces fonds pour contractualiser directement avec des prestataires chargés de la collecte et du traitement des déchets. À ce jour, rien n’est précisé concernant le montant des éco-contributions, qui devra être déterminé selon un barème fixé par chaque éco-organisme. Ce montant devrait varier en fonction du coût de traitement du déchet. Il est proposé qu’il soit réduit si le produit intègre des critères environnementaux et augmenté si le produit est très polluant. Cette approche inciterait les producteurs à concevoir des produits plus facilement triables, recyclables ou intégrant des matières premières issues du recyclage. Toutefois, plusieurs difficultés sont à prévoir dans la mise en œuvre efficace de ce concept.
Comment garantir une gestion efficace des déchets face à la diversité des filières ?
Sans une réglementation spécifique aux différentes filières génératrices de déchets, la gestion reste complexe, car chaque catégorie de déchets nécessite un mode de traitement particulier. Cette situation requiert un texte d’application permettant d’introduire et d’encadrer ces filières de manière adaptée. En effet, le rôle d’un éco-organisme diffère selon qu’il s’agisse de déchets d’emballages ménagers, de déchets électriques et électroniques ou encore de véhicules hors d’usage. Prenons l’exemple d’un producteur de produits d’entretien qui met en vente une bouteille d’eau de Javel. Lorsqu’il commercialise ce produit, il verse une éco-contribution, supposons un dinar par bouteille, à l’éco-organisme concerné. Par la suite, lors de la collecte sélective des déchets organisée par la commune, les agents de nettoiement récupèrent l’emballage plastique. Celui-ci est ensuite envoyé vers un centre de tri afin d’être recyclé. L’éco-organisme intervient alors en soutenant financièrement la commune pour la collecte sélective et le recyclage, ce qui contribue à réduire les coûts de gestion locale. Toutefois, pour que ce modèle fonctionne efficacement, plusieurs conditions doivent être réunies. Il est essentiel de garantir l’existence de centres de tri performants, de développer un réseau d’entreprises spécialisées dans le recyclage et, surtout, de réussir à sensibiliser les citoyens à l’importance du tri sélectif. Or, ce dernier point reste un défi majeur en Algérie, où les initiatives de tri sélectif peinent à s’imposer, nécessitant ainsi un long programme de sensibilisation et d’accompagnement.
Comment assurer une gestion efficace des déchets électroniques face à leurs défis spécifiques ?
La gestion des déchets électriques et électroniques pose des défis bien plus complexes que celle des déchets d’emballage. Téléviseurs, ordinateurs portables et de bureau ainsi que leurs composants internes deviennent rapidement obsolètes et se transforment en déchets difficiles à traiter. Leur composition variée, à savoir métaux, plastique, verre, mais aussi substances toxiques comme le cadmium, l’arsenic, le mercure, le plomb et le polychlorure de vinyle, accentue la problématique environnementale et sanitaire. Contrairement aux déchets plus classiques, le traitement des équipements électroniques en fin de vie nécessite un processus rigoureux, incluant la récupération, la réutilisation, la réparation, la valorisation et, en dernier recours, l’élimination. Ce cycle exige des investissements considérables, et son financement devrait être assuré par les producteurs eux-mêmes. Ces derniers sont appelés à mettre en place un programme complexe de collecte et de valorisation des produits mis sur le marché. Pour alléger cette charge, plusieurs entreprises peuvent mutualiser leurs efforts et créer des structures collectives de gestion des déchets électroniques. Toutefois, un autre enjeu de taille demeure : les consommateurs doivent avoir un accès facilité à des points de collecte adaptés, sans contraintes logistiques dissuasives. Une fois les produits récupérés, il est impératif que leur traitement suive une hiérarchie stricte, allant du tri au démontage des équipements informatiques. Les matériaux extraits sont ensuite acheminés vers des recycleurs spécialisés, qui doivent impérativement employer des technologies adaptées afin de limiter l’impact environnemental et sanitaire. Reste une question cruciale : l’Algérie dispose-t-elle réellement d’infrastructures et d’entreprises capables de traiter et de recycler efficacement ces déchets ? Et comment gérer les composants les plus dangereux, tels que le plomb et le mercure, qui constituent une menace majeure pour l’environnement et la santé publique ?
Comment renforcer la responsabilité des entreprises et des plateformes de vente dans la gestion des déchets ?
La complexité croissante de la gestion des déchets en fin de vie devrait inciter progressivement les entreprises à réduire, voire éliminer, l’usage de substances toxiques dans leurs produits. L’article 3 encourage cette démarche, et un système de redevances proportionnelles à la quantité de substances nocives contenues dans les produits pourrait constituer un levier efficace pour accélérer cette transition. Une telle approche pousserait les fabricants à revoir la composition de leurs produits pour limiter leur impact environnemental. Cependant, un point crucial semble avoir été négligé : si l’article 3 mentionne les producteurs et les émetteurs de produits sur le marché, il ne fait aucune référence aux plateformes de vente en ligne et aux services de livraison qui facilitent la distribution de produits soumis à la responsabilité élargie du producteur (REP). Une question se pose alors : ces plateformes devraient-elles être tenues de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus des produits qu’elles commercialisent ? Si elles ne sont pas intégrées au dispositif, le nombre de non-contributeurs aux filières REP risque d’augmenter, créant ainsi une faille dans l’application de la réglementation. Normalement, ces plateformes, en tant qu’intermédiaires, devraient assurer la responsabilité REP des produits qu’elles commercialisent, sauf si les producteurs eux-mêmes prennent déjà en charge cette obligation. Par ailleurs, la loi 25-02 a introduit une révision des dispositions pénales, renforçant la répression pour les infractions environnementales. L’aggravation des peines est une avancée significative qui s’inscrit dans une logique de dissuasion, en partant du principe que l’augmentation des sanctions réduit la fréquence des infractions. Cette évolution est d’autant plus nécessaire que les magistrats sont aujourd’hui confrontés à une hausse des contentieux liés aux atteintes graves à l’environnement, notamment en matière de gestion des déchets. Dans ce contexte, il apparaît essentiel de renforcer la formation des magistrats à la justice environnementale. Face à des décisions qui requièrent non seulement une solide maîtrise des textes juridiques, mais aussi une compréhension approfondie des enjeux écologiques, ces derniers doivent développer une véritable expertise en droit de l’environnement. En tant que garants de l’application de la réglementation, ils jouent un rôle déterminant dans la lutte contre la mauvaise gestion des déchets et doivent être dotés des outils nécessaires pour sanctionner efficacement les contrevenants.
Comment renforcer la sensibilisation et l’innovation pour une gestion durable des déchets ?
Il n’existe pas de solution miracle pour rendre plus efficace la mise en œuvre de cette loi. La gestion des déchets est un défi majeur pour les communes du monde entier, y compris dans les pays les plus développés. Chaque individu peut contribuer activement à cette mission, notamment grâce à la sensibilisation et l’éducation, qui jouent un rôle clé dans la réduction des déchets. En renforçant les programmes éducatifs, les citoyens peuvent mieux comprendre l’importance de limiter leur production de déchets et d’adopter des comportements écoresponsables, comme la modification des modes de consommation et le tri à la source. Cette approche proactive favorise un apprentissage actif et encourage la mise en place de vastes campagnes de sensibilisation. Une action quotidienne simple, comme le tri des déchets ménagers, améliore leur taux de valorisation et la qualité des matières recyclables. À titre d’exemple, la récupération anarchique du plastique par le secteur informel engendre des désordres sanitaires pour les villes et complique le travail des agents de nettoiement. Le développement du compostage des déchets organiques, à l’échelle des ménages et des espaces publics, pourrait également apporter une solution écologique efficace. Le ministère de l’Environnement et de la Qualité de la vie devrait investir davantage dans la formation des formateurs pour renforcer les compétences en éducation, communication et sensibilisation à une gestion rationnelle des déchets. L’atteinte de ces objectifs nécessite également une évolution des modes de financement du secteur afin d’inciter les ménages et les entreprises à adopter des comportements plus vertueux en matière de production, de consommation et de tri sélectif. Il serait pertinent d’inclure dans la prochaine stratégie nationale de gestion des déchets des objectifs quantifiables, comme la réduction du taux d’enfouissement, la diminution des déchets produits par habitant ou encore le renforcement des partenariats avec les entreprises locales d’ici à 2030 ou 2035. Un aspect pourtant négligé par cette loi reste le gaspillage alimentaire. Chaque année, plusieurs millions de tonnes de déchets alimentaires sont générés en Algérie, provenant de l’ensemble de la chaîne alimentaire, c’est-à-dire la distribution, la restauration, les cantines scolaires, les ménages. Il est essentiel d’intégrer des mesures strictes de lutte contre ce phénomène, en en faisant un objectif national à la croisée des enjeux économiques et environnementaux. À cet effet, il serait judicieux d’adopter une loi spécifique sur le gaspillage alimentaire et énergétique dans le cadre de l’économie circulaire, ainsi qu’une stratégie nationale ambitieuse contre ce fléau. Comme le disait Gandhi,
«vivre simplement pour que tous puissent simplement vivre». Enfin, encourager l’innovation verte dans la gestion des déchets est une priorité. De nombreuses solutions émergent et transforment l’approche du traitement des déchets par leur ingéniosité et leur efficacité. Parmi ces avancées, les projets innovants issus des universités jouent un rôle clé. La création d’un master en gestion des déchets au sein de la faculté des sciences biologiques et agronomiques pourrait constituer un outil précieux pour accompagner la mise en œuvre de la nouvelle politique de gestion des déchets.
A. A.