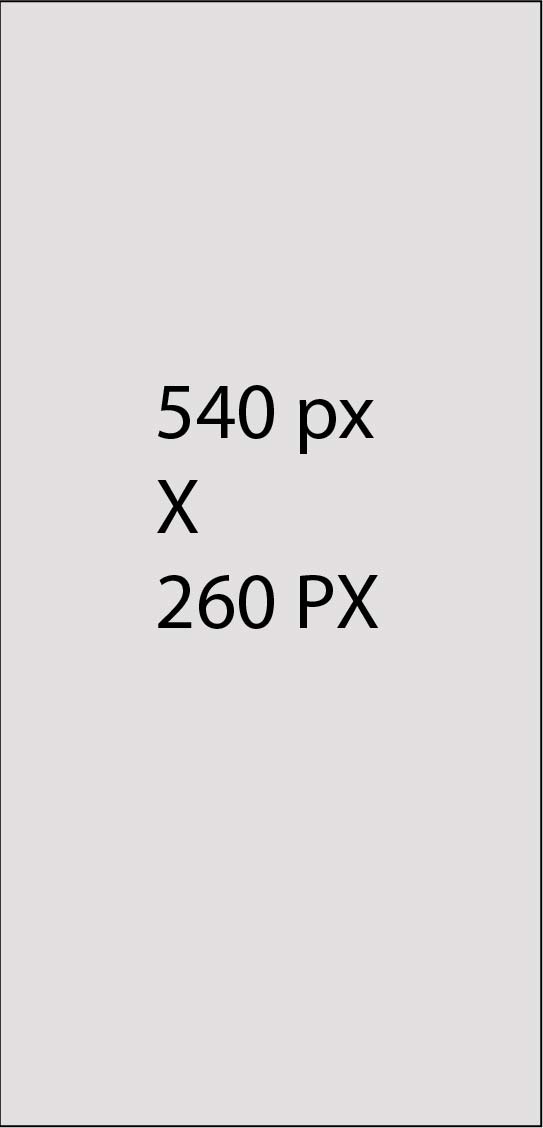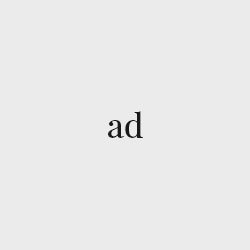Comme à chaque fois que l’opportunité se présente, le Musée national du Bardo d’Alger présente sur son site internet et sur certains réseaux sociaux, un objet du mois. Pour septembre 2024, il a exhibé un «crochet de pierre polie» daté d’environ 10.000 ans avant Jésus-Christ.
Il s’agit d’un hameçon utilisé pour la pêche. Il a été localisé à Bordj Badji Mokhtar, dans l’extrême sud du Sahara algérien. «Il est apparu à l’époque préhistorique et plus particulièrement à l’époque moderne de l’âge de la pierre dans le sud de l’Algérie. Il est considéré comme un témoin de la pratique de la chasse dans ces zones désertiques» du pays, selon le texte qui accompagne cet outil.
«Ce hameçon est un crochet en pierre que l’on attache au bout d’une ligne pour pêcher du poisson. Son usage remonte à la préhistoire, durant la période du néolithique, dans la région du Sud algérien […] Il est de taille moyenne, de forme allongée, avec deux pointes aux extrémités, l’œillet est au milieu de la hampe», précise le texte. Les précédents objets présentés en août et juillet sont des anneaux de cheville et des trilobites (paléozoïque) disparus il y a 250 millions d’années.
Le musée du Bardo renferme un véritable trésor archéologique et anthropologique, provenant des différentes régions du continent africain, dont des sculptures, des bijoux, des objets et des attributs royaux, des objets de vannerie et des instruments de musique. Cependant, tous ces objets qui disent, qui chantent, qui racontent notre histoire, celle de l’Algérie, celle de l’Afrique en général, ne sont malheureusement pas exposés, comme ce fut le cas dans les décennies 1970 et 1980. Ils sont rangés dans la réserve.
Mais le visiteur en sort charmé par la villa elle-même, son architecture, les richesses artistiques de ses faïences, de ses portes ornées de clous en fer sculpté. La villa est unique en son genre. Elle ne ressemble à aucune autre bâtisse mauresque de la période l’occupation ottomane de l’Algérie. Le visiteur est émerveillé, subjugué par la villa. Il ne se lasse pas d’admirer son architecture et ses murs tapissés de faïences ramenées de Hollande, d’Italie et d’autres pays, d’apprécier ses superbes chambres et ses portes cloutées, se laisser bercer par cette sérénité profonde qui se dégage de cette extraordinaire maison blottie dans un océan d’une luxuriante verdure.
Une petite merveille d’art
Le Bardo abrite un magnifique jardin botanique renfermant une riche flore domestique et exotique. Il est «bâti avec une grande élégance et une recherche de style qui le classent parmi les types de plus parfaits de l’architecture turque et qui rappelle dans ses détails luxueux un des contes des Mille et une nuits. Une petite merveille de l’art». (01).
La bâtisse a subi plusieurs travaux de rénovation. La dernière en date, entamée en 2005, s’est achevée en 2013 avec une ouverture partielle du site. La tâche, qui constituait à reconstituer à l’identique la bâtisse, n’a pas été de tout repos. Le programme est revenu et réactualisé à plusieurs reprises, car au moment où les architectes et les ouvriers s’appliquaient à restaurer ou à rénover un endroit du site, ils découvraient encore des vestiges enfouis sous terre. C’est le cas des bassins de rétention des eaux pluviales dotés d’un «système de vanne et de déversoir». Ces constructions, qui datent de différentes époques, «ont été confortées et annexées aux espaces existant y attenants», est-il mentionné dans un dépliant consacré aux étapes de la restauration au musée du Bardo.
Les travaux lancés en 2005, qui ont nécessité la fermeture complète du musée depuis 2010, ont porté sur l’ensemble des parties abîmées ou endommagées de la villa. Celle-ci compte plusieurs bâtiments aussi splendides les uns que les autres. Ils ont porté, pour ne citer que ces exemples, sur la réfection des murs, la reconstitution des céramiques, la vitrerie, l’ébénisterie, les marches d’escaliers, les structures porteuses, les planchers en bois et en béton armé, les réseaux d’assainissement, l’étanchéité, le décapage de couches successives de peinture des colonnes, chambranles et barreaudages en fer forgé. Tous ces travaux ont été réalisés dans
«le respect de l’œuvre historique et artistique telle qu’elle nous a été légué, sans rejeter le style d’aucune époque», précise le même dépliant.
La villa aurait été construite sur une parcelle de la vaste propriété de Mustapha Pacha qui s’étendait sur l’ensemble des terres allant de l’actuel Hôtel El-Djazaïr (ex-Saint George) jusqu’à la place du 1er-Mai (ex-Champs-de-manœuvre), y compris les secteurs proches du marché Ferhat Boussad, dont l’hôpital qui porte son nom (Mustapha-Pacha). Elle a été bâtie au 18e siècle par un prince d’origine tunisienne du nom de Mustapha Ben Omar, selon Mohamed Benmeddour (02). Elle est devenue ensuite la propriété d’Ali-Bey, agha de Biskra, puis successivement du général français Maurice Exelmans (1848), de Lichetlin, Baccuet, Graudy, veuve Aziza Alexandre-Foa-Claude-Prosper Cusson (née Bacri) et Pierre Joret.
Admirable architecture
Après le décès de Joret, sa sœur, Mme Frémont, vend la villa aux Domaines. L’administration coloniale en a fait un musée ouvert à l’occasion de la célébration du centenaire de la colonisation 1830-1930.
La villa avait subi des changements. Chacun des propriétaires en avait apporté sa petite touche. Pierre Joret, dernier propriétaire des lieux à partir de 1879, avait construit dans la partie de la bâtisse des locaux et des écuries. Passionné d’art et de musique, Joret y organisait des expositions et des concerts. «Pour abriter les collections de valeur» qu’il avait lui-même ramenées d’Orient et d’Occident, il avait «apporté des transformations à la demeure». Il avait effectué de «larges passages taillés dans les murs de moellons au niveau de la partie basse» et ajouté «une grande salle donnant sur la cour supérieure», selon le dépliant cité plus haut. Camille Saint-Saëns, le compositeur de Samson et Dalila et de Tarentelle pour flûte et clarinette – une danse qui guérit de tout, disait-on – se serait produit une fois dans cette grande salle ?
Le musée Bardo avait servi, aussi, au début des années 1930 de décor pour quelques scènes d’intérieures du film «El-Guelmouna, le marchand de sable» d’André Hugon, sorti en 1932. Le film tiré d’un roman de Georges-André Guel avait été tourné à Ghardaïa, dans lequel avait joué Tahar Hannache, de son vrai nom Tahar Ben Kouider Belhannache, né le 26 novembre 1898 à Constantine. Il est considéré comme le pionnier du cinéma algérien.
Sa première apparition dans un film remonte à 1921, dans Atlantide, du réalisateur Jacques Feyder. Sa première production cinématographique intitulée «Aux portes du Sahara» date de 1938. Il l’avait produite avec sa propre boîte de production créée la même année. L’éclatement de la Seconde Guerre mondiale (1939/1945) avait compromis ses projets…
L’Algérie était considérée par le réalisateur André Hugon comme un gigantesque studio à ciel ouvert pour la production cinématographique. «Il est temps qu’Alger possède son petit studio, ne fusse qu’un simple dépôt de matériel […] Car Alger nous offre, dans un rayon de 150 à 200 km, la mer, la montagne, la plaine, la forêt, la neige, le désert […] C’est assurément le seul pays au monde qui puisse offrir cet avantage insoupçonné», dira-t-il (03).
La villa du Bardo est classée monument historique et musée en 1985. Elle abritait autrefois une réplique du squelette de Tin Hinan, la reine des Touaregs. Les bâtisses venues plus tard s’ajouter à la villa proprement dite sont le logement du conservateur, la villa d’hôte, le bâtiment de l’administration et le Centre de recherche préhistorique, anthropologique et historique (CRPPH, ex-CRAP) qu’avait dirigé, pendant de longues années, l’écrivain et anthropologue Mouloud Mammeri.
Le palais du Bardo, s’en est un effectivement, est une véritable merveille qui subjugue le visiteur par son admirable architecture et décoration. C’est plutôt ce qui fascine les touristes et les visiteurs. Le site figure pratiquement dans tous les circuits de la destination Algérie proposés par les tours opérateurs étrangers.
M. A. H.