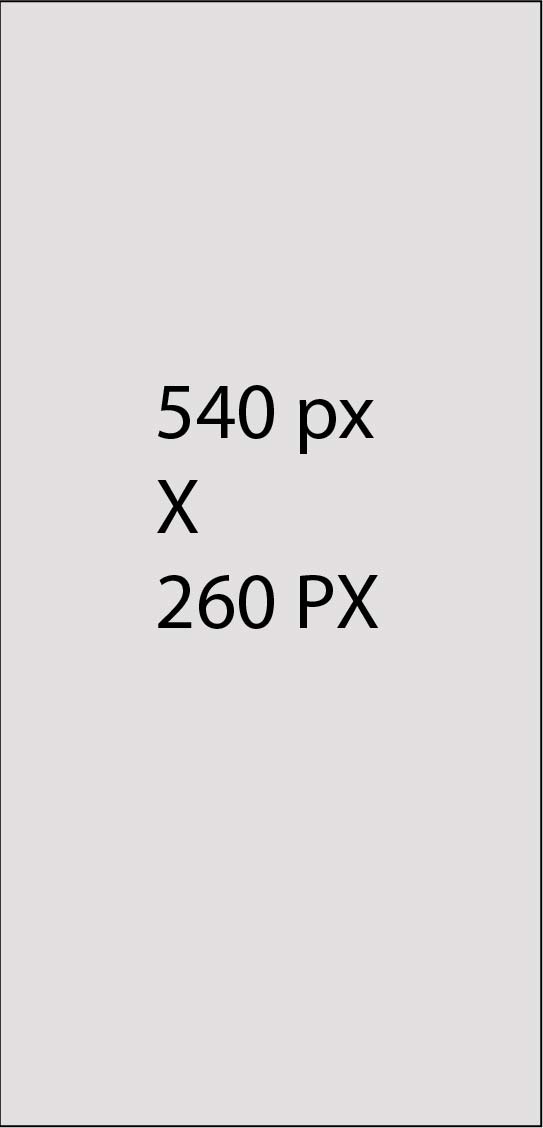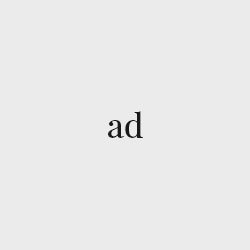Un site historique et touristique incontournable du centre nord du pays. Il attire un grand nombre de touristes, de visiteurs et autres voyageurs de passage dans le secteur. Il figure en bonne position sur les feuilles de route et les circuits proposés par les tours opérateurs, algériens et étrangers.
Il ne viendra pas à l’esprit d’un touriste ou d’un simple promeneur de traverser le Sahel algérois sans faire une escale au Mausolée royal de Maurétanie, plus connu sous les noms de Kbor Roumia et de tombeau de la chrétienne.
En plus de son côté historique, le site offre une merveilleuse vue sur la Méditerranée et le mont Chenoua, mais aussi et surtout sur l’immense et riche plaine agricole de la Mitidja, grenier des commerçants phéniciens, de Rome et de tous les envahisseurs qui se sont succédé en Algérie. Celle-ci s’étend sur plus d’une centaine de kilomètres de long et une vingtaine de kilomètres de large en moyenne.
Le Mausolée, d’une hauteur de plus de 32 mètres, occupe le sommet d’une éminence qui surplombe la ville de Sidi Rached et la rocade reliant Alger et Cherchell, sur une centaine de kilomètres. Il est visible des quatre points cardinaux. Sa structure compte plus de 80.000 m de pierres de grandes dimensions. Elle mesure 185,50 m de circonférence, 60,90 m de diamètre et 32,40 m de hauteur. Formée de 33 gradins, elle est entourée de 60 colonnes engagées de type ionique supportant une corniche. Elle comprend également quatre fausses portes donnant sur les quatre points cardinaux, ornées au centre de moulures ayant la forme d’une croix.
L’intérieur du mausolée renferme un caveau, un vestibule et un couloir circulaire voûté de 141 m. L’accès se faisait, autrefois, par une petite porte basse et étroite, située sous la fausse porte de l’est, à environ un mètre de profondeur de la plate-forme. Il se faisait uniquement sur les genoux, à quatre pattes. L’entrée dans l’antre du mausolée est interdite actuellement. Par contre, le site abritant le mausolée lui-même, fermé pendant 27 ans à partir de 1992 pour cause d’insécurité liée à la «décennie noire», a rouvert son portail le mois de mai 2019. Depuis, le nombre de visiteurs n’a cessé d’augmenter, grâce aux réseaux sociaux.
Le monument n’a pas livré ses secrets
«Le Mausolée royal de Maurétanie n’a pas livré, laissé percer tous ses secrets. Il en a fourni très peu depuis les deux premières fouilles effectuées respectivement en 1855-1856 et 1865-1866 par Adrien Berbrugger, fondateur du premier musée-bibliothèque d’Alger, et Oscar Mac Carthy, géographe et explorateur d’origine irlandaise. On n’avait découvert ni ossements humains ni cendres d’incinération.»
Donc, pour résumer, il n’y a «pas la moindre de trace du roi Juba II à qui on a attribué l’édification du monument, ni de sa femme Cléopâtre Séléné, fille d’Antoine et de Cléopâtre, ni de son fils Ptolémée, assassiné par son cousin Gaius Caligula à Rome, ou d’autres membres de la famille royale. On a tout juste, d’après les écrits du 19e siècle, trouvé, éparpillés sur le sol dans ses galeries, couloirs et caveaux, quelques petites perles en pierre rare, une poignée de pièces des 4e et 1er siècles, des fragments de bijoux, des débris de plats décorés de symboles chrétiens et des poteries de fabrication locale. Des poteries «ressemblant à la vaisselle kabyle actuelle (milieu du 19e siècle), mais d’aspect plus ancien. Elles jonchent le sol», selon Stéphane Gsell.
Après la mort de Ptolémée, le mausolée avait subi de nombreuses violations. Il était livré aux chapardeurs pendant des siècles, jusqu’à l’invasion arabe à la fin du VIIe siècle, selon Berbrugger. A commencer «par les Romains qui n’y laissèrent que de menus objets et des débris de poterie», écrivait le journal Le Tell du 18 septembre 1892 paraissant à Blida, à 50 km au sud d’Alger.
Berbrugger affirma que le mausolée fut, sans nul doute, édifié par Juba II. Car, souligne-t-il, «ce souverain épris de luxe et passionné pour les arts, qui fit de Iol (Cherchell), à peu près inconnu au temps de Bocchus, une ville somptueuse, un tombeau aussi grandiose convenait bien à un tel prince… ».
Une des légendes évoquant la disparition du prétendu trésor que renferme le mausolée pointait du doigt un sorcier espagnol. Ce quidam décida d’offrir la liberté à son esclave algérien, si celui-ci accepta de brûler une amulette, qu’il lui remit, à l’intérieur du mausolée royal de Maurétanie. Une fois le gri-gri incinéré, un pan du mur du monument s’effondra et laissa s’envoler dans le ciel de la Méditerranée des milliers de pièces en or qui atterrirent dans les poches du sorcier espagnol.
M. A. H.
Sources :
- – Liberté du 10 novembre 2021
- Guide archéologique des environs d’Alger, librairie Adolphe Jourdan, Alger, 1896