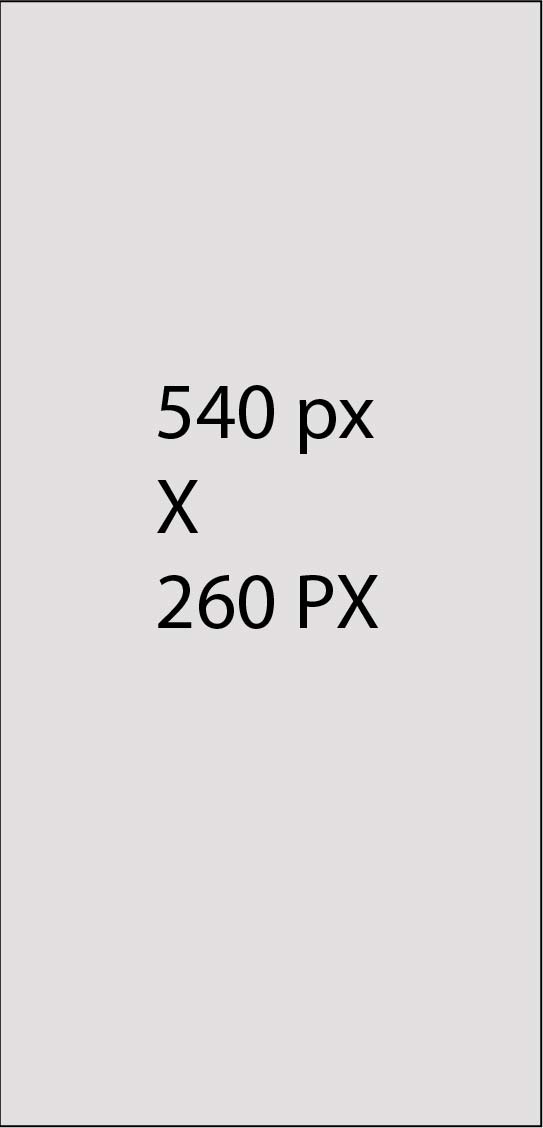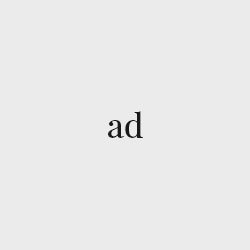Le centre des arts et de la culture, plus connu entre autres sous le nom de Bastion 23 et de palais des Raïs, est la plus importante bâtisse édifiée à Alger sous l’occupation ottomane. Mais elle est, malheureusement, la moins visitée.
Peut-être parce qu’elle se trouve à l’écart, éloignée, voire isolée des autres constructions ottomanes de la basse Casbah, à savoir Djamaa Ketchaoua, Djamaa Djedid, Dar Aziza, Dar Hassan Pacha, Dar Khedaoudj el-âmya qui abrite le musée des arts populaires, Dar El- Kadi et Dar Mustapha Pacha transformée en musée de l’enluminure, etc.
Les travaux sur le site ont été engagés en 1576 par Mami Arnaout et achevés en 1806. Ils ont porté d’abord sur la construction d’une toppanat, une batterie, afin de renforcer le système de défense élaboré et mis en œuvre sous le règne de Ramdan Pacha. La batterie comptait plusieurs canons, destinés à faire face à toute éventuelle attaque ou invasion étrangères. L’endroit serait le lieu de rencontre et de repos des officiers de la marine ottomane. C’était ici que se préparaient les « missions » contre les bateaux et autres navires de guerre et civils traversant la Méditerranée.
Le palais des Raïs constitue aujourd’hui l’unique témoin qui confirme l’extension de la Casbah jusqu’à la mer. Il renferme trois magnifiques palais, des pièces, un chemin entourant l’ensemble du complexe et une spacieuse terrasse surplombant la plage Qaâ Es-Sor (le bas du rempart). Le palais portant le numéro 18 est le premier à voir le jour. Ses deux premiers propriétaires furent le trésorier Kara Mustapha (1797) et le dey Hassan Pacha (1798) qui en fit sa résidence. La construction des deux autres palais 18 et 23 remontent au début du 19e siècle, selon des affiches vues sur les lieux.
UN VRAI CHÂTEAU
En fait, ce qu’on appelle le palais des Raïs est un véritable château. Il avait aussi servi successivement de prison pour des militaires disciplinaires du corps expéditionnaire français condamnés à des travaux forcés. Ces soldats avaient été employés, dès le début de la colonisation, à la réalisation de l’ex-jardin Marengo. Le palais avait été tour à tour résidence du commandant du génie militaire, pensionnat pour jeunes filles et bibliothèque. Le château avait connu d’autres appellations : Bordj Ezzoubia (bordj des détritus), « Sbaâ tbaren » (les sept tavernes) et Toppanat Arnaout (batteries d’Arnaout). Il offre aujourd’hui toutes les commodités pour des activités culturelles et artistiques. Activités qui se font malheureusement rares. Le palais avait subi différentes transformations, des rajouts, des aménagements et, aussi, des dégradations après son squat par des familles algériennes au lendemain de l’indépendance en 1962. L’abandon, les intempéries et l’eau salée de la mer avaient rajouté une couche aux dégâts précédents. La bâtisse avait été récupérée en 1981 par le ministère de la culture. Les travaux de restauration et de rénovation s’étaient étalés de 1987 à 1993. Son ouverture au public était intervenue le 1er novembre 1994, date symbole marquant le déclenchement de la guerre d’indépendance en 1954.
Le palais des Raïs avait failli, lui aussi, être livré aux marteaux des démolisseurs, dans le cadre du même « plan d’embellissement de la ville d’Alger », mijoté par Eugène de Redon à la fin du 19e siècle. Cet ingénieur civil, qui défendait bec et ongles son idée de « faire table rase » du quartier de la Marine, dans la basse Casbah, était revenu à la charge à maintes reprises sur le sujet. Il n’a cessé de demander le démantèlement de ce palais et son remplacement par l’édification d’un Casino, avec une emprise sur la mer afin d’augmenter le terrain d’assiette à 7000 m2.
L’ARCHITECTURE AUTOCHTONE DÉRANGEAIT
Hormis quelques constructions épargnées des griffes des personnages semblables à Eugène de Redon, des dizaines, voire des centaines d’édifices furent rasés. Les interventions « radicales » sur les tissus urbain savaientétémarquéesparlapercée des rues comme les rues Ali-Ammar (ex-Marengo), Bouzrina (ex-de la Lyre), l’ex- rue de Chartres. Les idées de sauvegarde et de préservation ne figuraient pas au programme.
Edouard Dalles relevait en 1888 que « l’Alger musulman que nous avons trouvé en 1830 achève de s’en aller par morceaux (…), le flot envahissant de notre population avec ses habitudes antipathiques à l’architecture indigène l’efface ou du moins l’altère profondément, partout où il peut l’atteindre. Une construction mauresque sera, avant un quart de siècle, une curiosité aussi rare pour les habitants d’Alger que pour les touristes européens » (Alger, Bou-Farik, Blida et leurs environs, Adouard Dalles, Adolphe Jourdan, éditeur, 1888, Alger).
Pour cet auteur, la politique de démolition mise en œuvre « serait un vandalisme capable de déshonorer même une nation barbare ». Il n’était pas le seul à tomber à bras raccourcis sur la démarche mise en branle dès les premiers jours de la colonisation, d’abord par le génie militaire, puis par des particuliers.
En l’espace de neuf ans, de 1830 à 1839, les statistiques signalaient déjà la destruction de 646 maisons et 7 mosquées. Durant la même période, 218 maisons européennes furent édifiées sur les ruines des bâtisses rasées, dont 30 à la haute Casbah, pour les besoins des différents services de l’armée. Le centre des arts et de la culture, plus connu sous le nom de Bastion 23, est classé patrimoine national en 1909, puis patrimoine mondial par l’Unesco en 1992.