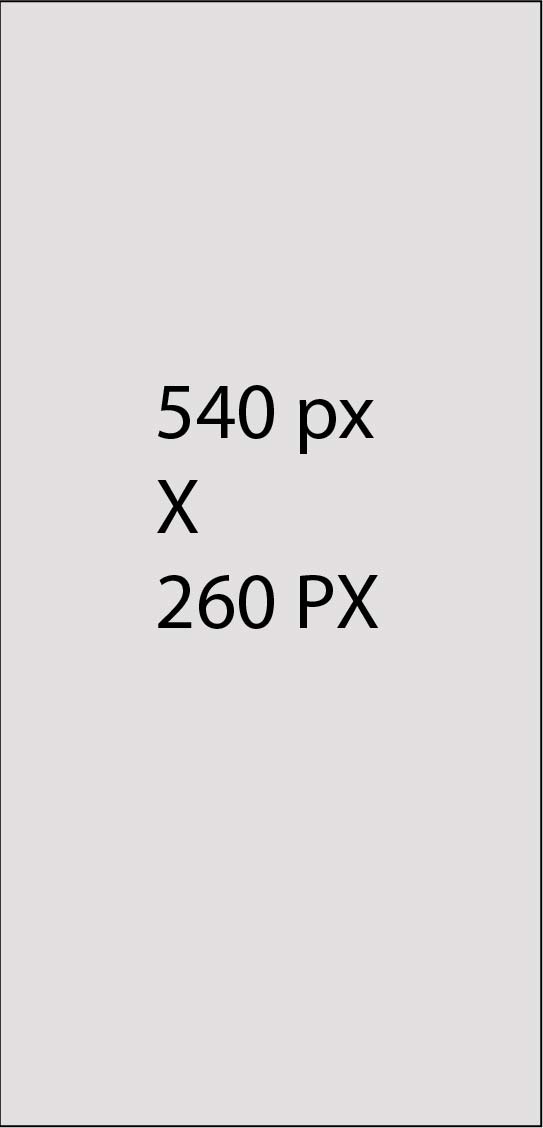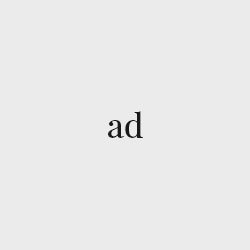L’approche de l’Algérie face à ce phénomène repose sur l’idée que la solution doit être d’abord et avant tout africaine, comme l’a souligné le docteur Bezzaz. «L’Algérie plaide pour une réponse régionale autonome, exempte d’interventions extérieures qui ont aggravé l’instabilité et le chaos dans la région», a-t-il précisé.
Le secrétaire général de l’Union des scientifiques, prédicateurs et imams des pays du Sahel, le docteur Lakhmissi Bezzaz, a souligné, hier, sur les ondes de la Radio nationale, l’importance de l’approche globale de l’Algérie face au phénomène complexe du terrorisme qui a fait des ravages dans plusieurs pays de la région du Sahel.
L’Algérie, confrontée de près au terrorisme lors de la décennie noire des années 1990, a su développer une stratégie de lutte multidimensionnelle, alliant à la fois des solutions sécuritaires et non sécuritaires. Selon le docteur Bezzaz, «l’Algérie a agi seule pendant une période où le monde percevait le terrorisme comme une menace lointaine, dont il ne mesurait pas encore l’ampleur», ajoutant que «grâce à son expérience unique, l’Algérie a su créer une dynamique de coopération régionale, en mettant l’accent sur la lutte contre le terrorisme au Sahel par des moyens à la fois militaires et intellectuels».
Le docteur Bezzaz a affirmé que «l’une des erreurs majeures des puissances extérieures réside dans leur vision réductrice et sécuritaire du phénomène, ne tenant pas compte des causes profondes du terrorisme».
Evoquant les récentes statistiques qui montrent l’ampleur du phénomène, il dira qu’en 2023, le nombre de victimes du terrorisme dans la région du Sahel a atteint 3.200 personnes, avec le Burkina Faso enregistrant le plus grand nombre de morts, soit 1.500 victimes. Aux yeux du docteur Lakhmissi, ce chiffre alarmant reflète «l’ampleur de la menace terroriste dans la région», exacerbée par «la transition de Daech et d’Al-Qaïda vers d’autres zones», laissant un vide que de nouveaux groupes ont rapidement comblé, soulignant que «les groupes terroristes dans cette zone sont désormais mieux armés et plus structurés, ce qui augmente leur capacité à semer la terreur».
S’inspirer du modèle de la diplomatie religieuse de l’Algérie
L’approche de l’Algérie face à ce phénomène repose sur «l’idée que la solution doit être d’abord et avant tout africaine», comme l’a souligné le docteur Bezzaz, précisant que «l’Algérie plaide pour une réponse régionale autonome, exempte d’interventions extérieures qui ont aggravé l’instabilité et le chaos dans la région», citant au passage la création du groupe Simoc (Système interafricain de coordination et d’opération conjointe) pour les chefs d’état-major et la mise en place d’une cellule de communication et de coordination contre le terrorisme, qui constituent, selon lui, des «exemples de cette approche proactive».
Le docteur Bezzaz estime que «le facteur religieux joue un rôle central dans la dynamique du terrorisme, surtout dans le Sahel, où les groupes extrémistes se servent souvent de la religion pour manipuler les masses». Et d’affirmer que «l’Algérie, de par son histoire et son enracinement dans des valeurs religieuses profondes, met en avant la dimension religieuse dans sa lutte contre l’extrémisme».
Dans le même sillage, il a cité la Ligue des scientifiques, prédicateurs et imams des pays du Sahel, initiée par l’Algérie, qui, selon, lui, «constitue un véritable levier de diplomatie religieuse pour promouvoir une culture de la paix et de la cohésion dans la région», indiquant que l’objectif de cette ligue est de «fournir un contrepoids aux idéologies extrémistes en renforçant le savoir religieux authentique, capable de désamorcer les discours de haine et de division».
A ce propos, il a souligné que l’Algérie, forte de son statut de puissance régionale, a fait de la diplomatie religieuse «un pilier de sa politique extérieure». Ce modèle de diplomatie, qui s’appuie sur des valeurs de solidarité et d’unité, vise, selon lui, «à renforcer la sécurité et la stabilité dans la région du Sahel. La collaboration entre les pays africains, sous la houlette de l’Algérie, dans des forums comme celui de la Ligue des oulémas, prêcheurs et imams du Sahel (LOPIS), est un exemple de cette stratégie».
La question des ressources et de l’influence étrangère
Lors d’une conférence académique organisée, samedi dernier, à Ouargla, les chercheurs et les hommes de culte ont insisté sur «l’importance du référent religieux algérien pour instaurer une immunité face aux menaces qui pèsent sur la région».
Un autre aspect clé abordé par le docteur Lakhmissi Bezzaz est la question des «ressources naturelles et de leur exploitation par des forces extérieures. Dans une région riche en ressources, mais marquée par la pauvreté et la fragilité institutionnelle, le terrorisme et les conflits sont parfois utilisés comme des instruments pour accéder à ces ressources», mettant en garde contre «la présence de puissances étrangères», qui, selon lui, «ne cherchent qu’à piller les ressources africaines sous couvert d’interventions sécuritaires», tout en rappelant que «l’Algérie reste ferme sur sa position», arguant que la solution au terrorisme dans le Sahel doit être menée par les pays africains eux-mêmes, avec l’appui d’initiatives régionales solidaires, et non par des interventions étrangères.
Yanis Aït-Lamara