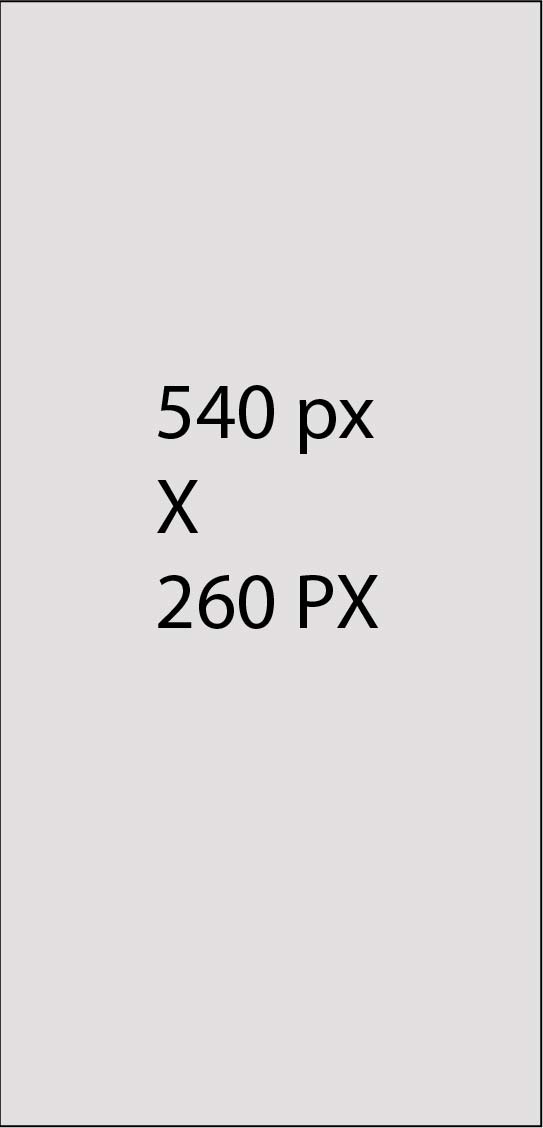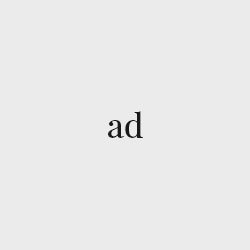Il y a 70 ans, l’Algérie prenait son destin en main, en déclenchant une guerre de libération contre l’occupant français, présent sur le sol algérien depuis 1830, qui a marqué l’histoire des luttes des peuples opprimés. C’était dans la nuit du 1er Novembre 1954. Armés de courage et du sens du sacrifice pour leur pays, les Algériens se lancèrent dans une bataille déséquilibrée, mais qui s’est avérée, notamment depuis les massacres du 8 mai 1945, comme la voie salvatrice pour le pays.
Les massacres du 8 mai 1945 ont incontestablement forgé la conscience nationale, et ce, fut le déclic, suivi par une maturation de l’idée qui a fini par faire l’unanimité au sein de la majorité des Algériens. Celle de l’action armée, option discutée et entérinée à l’occasion de la réunion des 22, tenue en juin 1954.
C’est à partir de cette date qu’ont été mis en place les outils nécessaires pour le lancement de la guerre de Libération. Et le déclenchement de la guerre, dans la nuit du 1er novembre, est venu consacrer le caractère populaire et national de la lutte des Algériens pour l’indépendance du pays. La propagande française venait de recevoir un coup de massue, elle qui a tenté de minimiser l’impact des faits et l’ampleur de l’attaque que venaient de subir ses installations et son administration.
Choquées par la tournure des évènements, les autorités françaises ont recouru, comme riposte, à une brutalité sans pareille. Mais cela n’a pas altéré la détermination des Algériens, décidés à arracher l’indépendance du pays, en dépit du soutien dont bénéficiait la France de la part des pays occidentaux.
Il ne fait point de doute que cette date marque une rupture avec les certitudes établies par l’Occident, en particulier par la France, qui se considérait comme le gardien des principes universels du droit et de la morale.
Lorsqu’on relit la Déclaration du 1er novembre, son contenu est certes un appel pour la lutte armée, mais c’est aussi un appel à la paix, à la négociation dans l’attachement à la volonté du peuple algérien et sa forte détermination à en finir avec l’ordre colonial qui n’avait que trop duré.
Avec l’aboutissement de cette révolution à l’indépendance du pays, la révolution algérienne a remis en question cette logique préétablie, car les Algériens ne souhaitaient plus rester confinés dans un cadre imposé. Ils ont fait le choix de prendre leur destin en main, quitte à risquer leur vie, convergent à dire les historiens les plus crédibles, français y compris.
Cette révolution était une réponse au refus français de reconnaître la souveraineté du peuple algérien. Les Algériens ont affirmé leur identité, leur vérité et leur vision de l’avenir et cela a eu des répercussions fortes au-delà des frontières.
Certains affirment, à juste titre, que la révolution algérienne a été une source d’inspiration pour de nombreux mouvements révolutionnaires à travers le monde. C’est le cas notamment de l’Afrique du Sud et de la Palestine où des leaders emblématiques comme Yasser Arafat et Nelson Mandela ont été directement influencés par le mouvement algérien.
Autant dire que l’esprit de Novembre a alimenté les luttes d’autres peuples en quête de leur émancipation. C’est le cas même aujourd’hui, 70 années plus tard, puisqu’à chaque fois qu’un mouvement de résistance est déclenché en Afrique, en Asie, voire même en Amérique, c’est Novembre 54 qui est systématiquement évoqué. C’est dire que la révolution de novembre est un modèle pour tous les gens et peuples en lutte. Il s’agit, à ce propos, de l’autre leçon administrée par Novembre. Celle de dire que la révolution du peuple algérien a engendré des mouvements d’émancipation dans les quatre coins du globe. Novembre a ainsi diffusé l’idée selon laquelle la liberté des peuples est un combat universel.
Prolongement des résistances populaires
Et si le 1er novembre a constitué la date de naissance de la révolution, il faut souligner tout le parcours de résistance qui a eu avant ce rendez-vous avec l’histoire. A l’évidence, le peuple a résisté de manière courageuse, sous la direction de l’Émir Abdelkader, Lala Fatma N’Soumer, Cheikhs Aheddad, El Mokrani et Bouamama…
A cet effet et contrairement à ce que peut suggérer une lecture superficielle de l’histoire de l’Algérie, le rejet qu’ont exprimé les Algériens du système colonial ne date pas de 1954, année du déclenchement de la révolution.
En effet, la présence française en Algérie n’a jamais été acceptée par les Algériens qui ont lutté contre cet ordre colonial dès 1830, comme peuvent l’attester toutes les résistances menées dans les quatre régions du pays.
Parmi ces résistances, figure celle de l’Emir Abdelkader dans l’Oranais. Le combat de l’Emir Abdelkader aura constitué une étape importante dans l’histoire de la longue résistance du peuple algérien contre la conquête française. Il a été considéré par les historiens, algériens et français, comme le plus redoutable adversaire de la conquête française.
Son projet de fonder un État algérien ne pouvait en effet se concilier avec la politique des colonisateurs. En ce qui concerne les combats menés par l’enfant de Mascara, l’histoire montre qu’il a alterné les victoires et les défaites jusqu’à être battu par Bugeaud en 1836 après la défection de plusieurs tribus de l’Ouest algérien. En 1837, la signature du traité de la Tafna scelle le statu quo.
Pour des historiens algériens, l’Emir Abdelkader a été et restera un symbole de la lutte et de la résistance contre l’occupant à travers le temps, en dépit des tentatives d’oubli et de déni dont a fait l’objet son histoire. Le fondateur de l’Etat algérien moderne n’a pas eu droit aux recherches et études qu’il mérite sur son long parcours historique en tant que résistant, homme de lettres, soufi et humaniste, relèvent sur une note de regret des historiens, pour qui l’homme de la résistance a toujours des aspects méconnus pouvant faire l’objet de recherche et d’ouvrages qui seront, sans doute, d’un grand apport pour l’écriture de l’histoire nationale.
Il y a eu également la résistance de Cheikh El Mokrani (1871) contre le colonisateur français qui avait joué un grand rôle dans le déblaiement du terrain pour laisser place à la glorieuse guerre de Libération.
L’histoire est témoin des œuvres d’El Mokrani et ses tentatives répétées d’expulser le colonisateur de la terre algérienne en déblayant la route pour laisser place à la glorieuse guerre de Libération qui a été couronnée par le recouvrement de la souveraineté nationale, selon le témoignage de la moudjahida Saliha El Mokrani, petite fille du Cheikh El Mokrani.
Selon Djamel Eddine Seddik, enseignant d’Histoire à l’Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi de Bordj Bou Arréridj, «la résistance du Cheikh El Mokrani est la deuxième plus violente résistance après celle menée par l’Emir Abdelkader, au point d’être connu sous le sobriquet de deuxième Emir».
Ces résistances, qu’il s’agisse de celle de l’Émir Abdelkader, de Lalla Fatma N’Soumer, des Cheikhs Aheddad, El Mokrani ou Bouamama, ont été circonscrites par l’armée française car elles n’avaient pas une dimension nationale.
Et cette «faille», Novembre a pu la surmonter à travers un soulèvement populaire et national, avec des marques de sympathie à partir de l’étranger. Le résultat fut l’indépendance du pays au bout de près de huit ans de lutte et de défiance de l’ordre colonial qui a usé de toutes les sauvageries en vue de semer la terreur chez les Algériens. Or, ces derniers avaient la détermination infaillible et l’engagement contre toutes les atrocités que le colonisateur a voulu le faire subir.
70 années plus tard, l’Algérie se rappelle de ce que fut l’ordre colonial et rend hommage à ses martyrs. Pour les Algériens, Novembre est éternel. Ses leçons sont intemporelles et universelles. Ses valeurs valent pour tous les peuples en lutte.
Mahmoud Aït-Braham