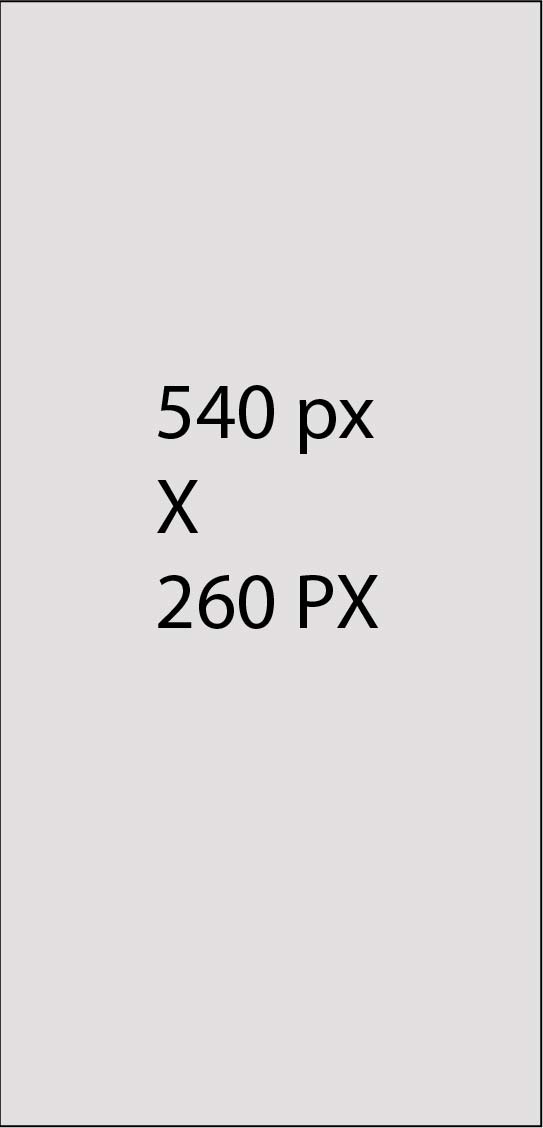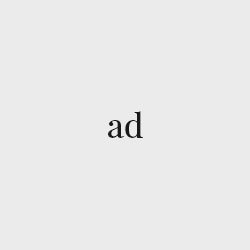Loin d’être de simples événements ou troubles spontanés, comme a tenté de les présenter l’administration coloniale durant plusieurs années, le soulèvement du 8 Mai 1945 qui a coûté la vie à plus de 45 000 citoyens algériens, victimes de la fureur et la barbarie du colonialisme français, n’a été qu’un signe de maturité du mouvement national et d’un engagement populaire sans faille pour le recouvrement de la souveraineté nationale.
En d’autres termes, cette date, avec son lot de victimes et la cicatrice indélébile qu’elle a laissée dans la mémoire collective, n’est autre que le prélude au déclenchement de la guerre de Libération nationale le 1er Novembre 1954. Comme le soulignait l’historien Mohamed Harbi, «désignés par euphémisme sous l’appellation d’événements ou de troubles du Nord-Constantinois, les massacres du 8 mai 1945 dans les régions de Sétif et de Guelma sont considérés rétrospectivement comme le début de la guerre algérienne d’indépendance».
Cependant, constituant une nouvelle étape dans la succession des actions de résistance menées antérieurement, les manifestations du 8 mai 1945 s’inscrivent dans la continuité du rejet de l’ordre colonial qui a été maintes fois exprimé. «Chaque fois que Paris s’est trouvé engagé dans une guerre – en 1871, en 1914 et en 1940 -, l’espoir de mettre à profit la conjoncture pour réformer le système colonial ou libérer l’Algérie s’est emparé des militants», rappelle aussi le même historien.
Pour revenir au contexte du début des années 1940, l’année qui a suivi le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, l’historien Charles-Robert Ageron a, pour sa part, relevé que «depuis 1944, toutes les autorités civiles et militaires [coloniales, ndlr] d’Algérie s’attendaient avec inquiétude à un soulèvement plus ou moins généralisé». Car, a-t-il précisé en 1995 dans un article sous le titre de «Mai 1945 en Algérie, enjeux de mémoire et histoire», dans la revue «Matériaux pour l’histoire de notre temps», n°39/40, «aux yeux de la majorité de la population musulmane, la défaite de la France en 1940 et la présence d’une armée américaine en Afrique du Nord signifiaient la fin de la domination coloniale».
Les prémices d’un mouvement indépendantiste de longue haleine
Cependant, ayant pour finalité la mobilisation populaire pour le rejet catégorique de l’ordre colonial, le soulèvement d’il y a 80 ans a bénéficié de l’adhésion de toutes les composantes et sensibilités politiques nationalistes de l’époque. «Le Manifeste du peuple algérien et la formation d’un grand rassemblement des Amis du Manifeste et de la liberté (AML), noyauté par le Parti du peuple algérien (PPA) clandestin [à cette époque], démontraient la force des aspirations indépendantistes», précise aussi Ageron à ce propos.
Ceci au moment où, sur le plan socioéconomique, le contexte n’a pas été moins favorable pour l’explosion de la révolte de la population algérienne contre l’ordre colonial. L’historien Mohamed Attar évoquait récemment des conditions sociales des Algériens complètement détériorées à la veille du 8 mai 1945. «Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Algériens ont été expropriés de leurs terres pour nourrir l’Europe, alors que sur le plan politique, les Algériens ont rejeté toute idée de naturalisation du décret du 7 mars 1944, notamment après la déclaration du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques [MTLD] qui a contribué à unir davantage les sentiments de la nation», rappelait-il dans sa description du contexte politique et social de l’époque.
C’est donc dans ce climat que sont déclenchées, le 8 mai 1945, les grandes manifestations et les premières vagues de violence avec lesquelles l’armée coloniale a accueilli les manifestants. Ce jour-là, à Sétif, des milliers de citoyens brandissent des drapeaux algériens et défilent pour appeler à l’indépendance, en bravant l’interdiction de ces manifestations que l’administration coloniale avait tenté d’imposer. Nourrissant un sentiment de haine démesuré à l’encontre des citoyens algériens exprimant leur engagement pour la liberté, la police coloniale intervient violemment pour disperser les manifestants. Des coups de feu sont tirés, et le jeune Bouzid Saâl, qui brandissait le drapeau algérien, a été froidement assassiné. Cet événement marque alors le début des massacres et les troupes coloniales se déchaînent contre la population algérienne sans distinction, emportant sur leur passage hommes, femmes, enfants, vieillards.
Déluge de feu contre des populations exprimant leur aspiration à la dignité
A Guelma, des manifestations similaires sont déclenchées le même jour. Ayant fait le tour des villes environnantes, la nouvelle des massacres de Sétif attise les tensions et la détermination des populations algériennes à ne jamais reculer devant la terreur que l’armée coloniale a enclenchée. Les affrontements éclatent alors entre manifestants et forces de l’ordre.
A Kherrata, où cette journée du 8 mai 1945 fut un jour de marché, bien qu’aucune manifestation ne soit prévue, près de 10 000 personnes, selon les estimations d’historiens, se sont rassemblées pour revendiquer la fin de la domination coloniale. Le lendemain, au milieu de la journée, l’armée coloniale mobilise son arsenal de guerre et tire froidement sur la population de la ville de Kherrata et des villages environnants ; suivront ensuite des tirs du bateau-croiseur «Duguay-Trouin», ayant bombardé les cimes des monts Babor, avant que la légion étrangère n’y débarque, faisant des centaines de morts.
Durant les jours qui ont suivi, la détermination des couches populaires n’a fait que s’accentuer, avec comme seul objectif se révolter contre la colonisation alors que l’armée coloniale redouble de férocité dans sa manière violente de s’en prendre à des manifestants qui, pourtant, dès le début, n’avaient pour objectif que de crier pacifiquement, haut et fort, leur rejet de la domination. «Les consignes sont claires : rappeler à la France et à ses alliés les revendications nationalistes, et ce, par des manifestations pacifiques. Aucun ordre n’avait été donné en vue d’une insurrection», écrivait Mohamed Harbi au sujet du caractère pacifique de ces manifestations.
L’un des pires crimes coloniaux de l’histoire contemporaine
Dans sa lecture de ces événements, l’historien Mohamed Attar estime que «par ces crimes, l’armée française voulait redorer son blason terni après avoir essuyé de grands revers de la part de l’armée allemande». Pour ce qui est de l’extrême violence avec laquelle les manifestants algériens ont été accueillis, il souligne que «les massacres du 8 Mai 1945 étaient prémédités dans l’optique de pousser le peuple algérien à enterrer ses aspirations, notamment le recouvrement de son indépendance nationale».
Ne dérogeant pas à sa logique répressive, l’armée coloniale noya les populations sous un déluge de feu, tout en étendant sa violence à d’autres régions du pays. Depuis la mi-mai, la répression devient systématique et les massacres se généralisent. Selon les témoignages recueillis par des historiens, l’armée coloniale met en place alors un dispositif de répression à grande échelle, avec des villages entiers qui sont encerclés, des habitants massacrés sans distinction. L’aviation est également utilisée pour bombarder des villages dans les localités environnantes.
A la fin du mois de mai 1945, la répression s’intensifie et devient méthodique, avec des opérations de ratissage n’épargnant aucune localité et des arrestations qui se multiplient. Cependant, des tribunaux militaires sont mis en place pour juger sommairement des Algériens accusés de participation aux troubles et les exécutions sommaires se multiplieront. Dans ce climat de violence inouïe, l’administration coloniale impose la censure et un contrôle strict de l’information, ne tolérant aucune fuite sur les massacres, avec l’intention de minimiser l’ampleur des crimes commis par son armée. C’est ainsi qu’avec un bilan de 45 000 Algériens massacrés d’une manière abjecte et sauvage, l’armée coloniale commet il y a 80 ans l’un des crimes contre l’humanité les plus manifestes de l’histoire contemporaine.
Mohamed N.