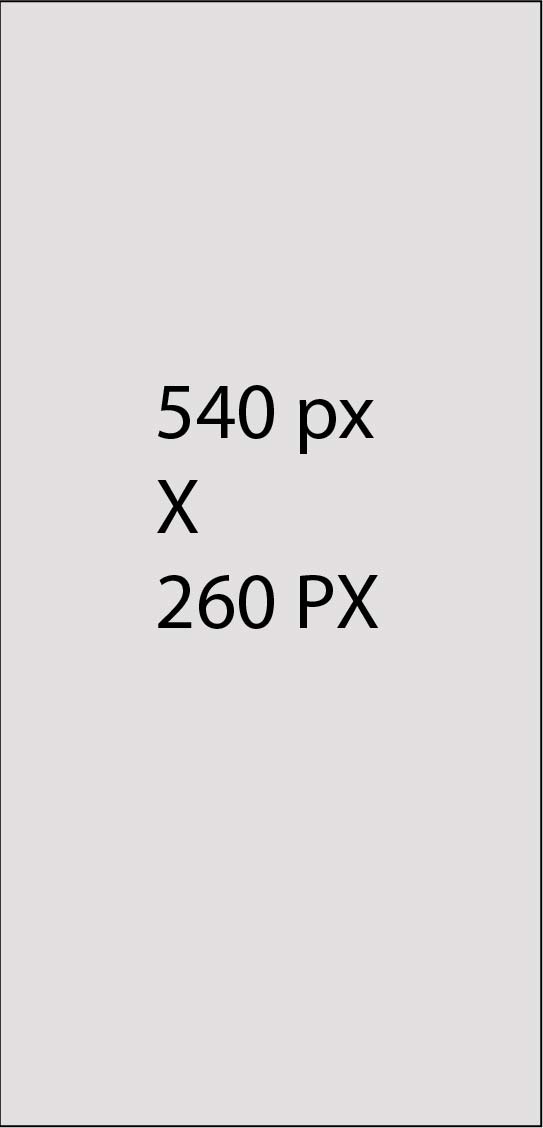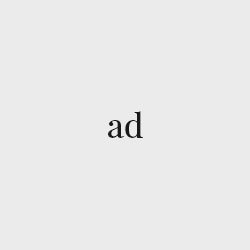Dans cet entretien qu’il a accordé à la «Voie d’Algérie», Fouad Soufi, historien, chercheur au CRASC et ex-cadre des archives nationales, revient sur des faits et des évènements qui ont conduit au déclenchement de la guerre de Libération nationale.
Quels sont, selon vous, les événements qui ont accéléré le déclenchement, le 1er novembre 1954, de la guerre de Libération nationale ?
Comme pour tout événement, il y a des causes profondes et des causes plus proches. Les tragiques événements de mai-juin 1945 ont provoqué ou relancé le débat, au sein du Mouvement national dans son ensemble, sur le choix entre lutte politique et lutte armée. Le premier parti national, le PPA, clandestin devenu MTLD, malgré ou à cause de ses victoires électorales avait choisi la voie de la lutte politique arguant, entre autres, le manque de préparation. C’est au sein de cette voie réformiste, pourtant, qu’est née la crise qui oppose le président du parti au comité central. C’est de cette crise qu’est issu le mouvement dit activiste ou neutraliste constitué des anciens de l’Organisation spéciale, l’OS.
Le noyau dur était composé des six, à savoir Boudiaf, Ben Boulaïd, Ben M’hidi, Bitat et Didouche, rejoint par la suite par Krim. Devant l’échec de leur volonté de réunir les deux forces antagonistes du parti (le CRUA) et pratiquement abandonnés par les Centralistes, les six procèdent alors à une sorte d’accélération de leur position. Ils convoquent cette fameuse réunion de 22. Désormais, la lutte armée est la seule et unique solution pour mettre fin au système colonial.
Dans le contexte de l’époque, peut-on dire que personne ne s’attendait, de part et d’autre, à cette guerre qui a permis à l’Algérie d’arracher son indépendance ?
Vous avez bien raison, le secret avait été bien gardé. Face à ce qui se passait en Tunisie et au Maroc, l’Algérie paraissait calme. Il y avait bien quelques signaux plus ou moins bien interprétés mais personne, parmi les plus hauts responsables français tant à Alger qu’à Paris, ne s’en était inquiété outre mesure, selon le témoignage du directeur de la sûreté nationale à Alger, Jean Vaujour. Et les services français de sécurité ont été pris au dépourvu.
Le colonel Schoen, chef du service des liaisons nord-africaines, qui prétendait tout savoir, tout comprendre, n’avait rien vu venir.
Il en est de même pour la population algérienne. Mais certains hommes politiques algériens ont dit avoir bien senti précisément que l’Algérie était trop calme.
Si l’on se réfère au témoignage d’Omar Boudaoud, Didouche Mourad avait pratiquement prédit cette situation. A son camarade Hahemi Hammoud, désemparé par la fin de non-recevoir de Messali Hadj à la proposition de Ben Boulaïd de prendre la tête du mouvement, Didouche Mourad aurait dit : «Nous nous lancerons la lutte et les autres seront arrêtés, car nous ne sommes pas connus» (cité de mémoire). De fait, dès le 4 novembre, de nombreux cadres et militants fichés furent arrêtés, sans conséquence aucune pour la suite des événements.
Malgré la propagande politique et médiatique des autorités françaises et la répression qui a suivi les premières attaques contre des cibles françaises, la lutte armée a continué et a pu s’étendre à d’autres régions du pays. Comment le FLN et l’ALN ont su faire adhérer davantage d’Algériens à ce combat libérateur ?
La propagande française n’a eu en vérité que peu d’effet sur la population en général. Bien au contraire. Comme la seule réponse du gouvernement français aux propositions de négociations contenues dans la proclamation du 1er Novembre, avait été la répression, le cycle guerrier s’est mis en place. Petit à petit, la population algérienne encore indécise ou restée dans l’expectative a fini par aider ou rejoindre l’ALN et le FLN.
La population algérienne était informée par la Voix de l’Algérie combattante par les radios des pays arabes, par Radio Budapest, qui avait diffusé la Proclamation du 1er Novembre. Il faut apprécier le rôle de la presse écrite comme Alger Républicain, par plus ou moins Oran républicain, appelé entre 1937 et 1939, le journal des Arabes, mais aussi une partie de la presse française, dont L’Humanité, Le Monde surtout. La presse quotidienne coloniale en donnant une information en creux de la situation politique en Algérie, en France et dans le monde, fait connaître l’existence d’affrontements et des actions du FLN dans les villes et de l’ALN. Dans les campagnes et les montagnes, et donc l’existence des moudjahidine et des fida.
Toutefois, il a fallu au FLN et à l’ALN de prendre des mesures coercitives contre les récalcitrants et les réputés traîtres accusés de collusion avec l’armée et la police coloniales.
Quelle est la part de contribution de l’émigration dans le déclenchement de la guerre en novembre 1954 ?
On retiendra surtout la contribution financière qui, selon certains, a contribué jusqu’à 80% du budget du GPRA. Mais il ne faut pas oublier le prix du sang dont la manifestation du 17 octobre 1961 à Paris n’est que la partie la plus visible.
Comment peut-on enrichir le récit national concernant cette date clé de notre histoire et assurer la transmission pour les générations futures ?
Encore faut-il se mettre d’accord sur ce récit qui se veut national. Il y a beaucoup à faire. Il faut commencer par éviter les dérives sectaires comme celle qui décrète que les Ulamas sont à l’origine du déclenchement de la Révolution. Alors que l’on sait qu’ils n’avaient même pas été sollicités par les initiateurs du mouvement. Il faudrait aussi rappeler que les trois du Caire, eux, ont été systématiquement informés et leurs avis entendus. Ils n’étaient donc pas six mais neuf historiques, même si Aït-Ahmed a récusé ce qualificatif. On trouvera ces neufs, et pas six en lisant El Moudjahid, édition yougoslave.
Il faudrait aussi publier les travaux des historiens qui remplissent les caves et greniers des universités. Il faudrait éditer ou plutôt rééditer et traduire les mémoires des acteurs. Diffuser et rediffuser les films documentaires et les mettre à la disposition du public et les émissions radiophoniques consacrées à notre sujet. Enfin et surtout, il faudrait rendre accessibles aux chercheurs et au public toutes les archives de cette période, et en particulier, celles du GPRA, du MALG et des wilayas historiques.
Alors et alors seulement ce récit sera national pourra non seulement être enrichi mais aussi être connu des générations actuelles, d’abord et surtout et des générations futures.
Entretien réalisé par Lyès Menacer