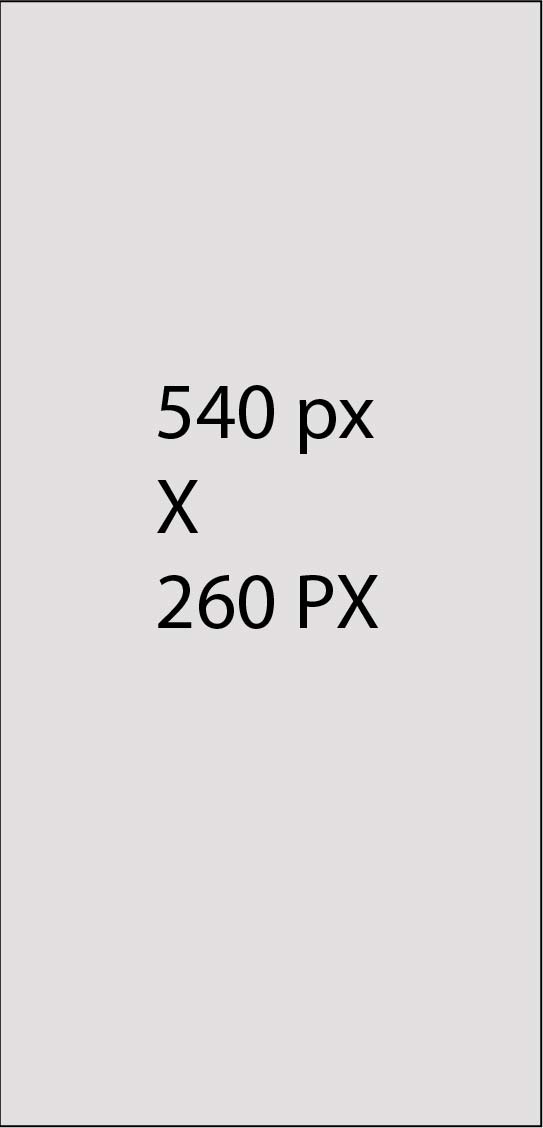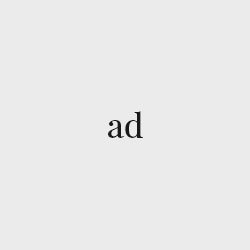Les conflits, les changements climatiques et la montée des prix alimentaires contribuent à aggraver l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le monde, à plonger des millions de personnes dans l’extrême pauvreté et à réduire à néant des gains de développement.
Des experts très au fait du secteur admettent que le développement de l’agriculture est l’un des leviers les plus puissants sur lequel on peut agir pour mettre fin à l’extrême pauvreté, renforcer le partage de la prospérité et nourrir les 10 milliards de personnes que comptera la planète en 2050, selon les estimations de la Banque mondiale (BM). Or, la production agricole est menacée par les effets croissants du changement climatique, en particulier dans les régions du monde qui souffrent déjà d’une insécurité alimentaire. Les systèmes alimentaires, eux-mêmes, contribuent aussi au changement climatique puisqu’ils sont à l’origine d’environ 30% des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES). Ces dernières années, les taux de croissance de la production agricole et du rendement des cultures, au niveau mondial, ont baissé. Ceci a conduit à craindre que la terre ne soit pas en mesure de produire suffisamment d’aliments et autres produits agricoles pour nourrir les populations futures selon leurs besoins. Les experts de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dans l’un de leurs derniers rapports sur les politiques agricoles, s’inquiètent du ralentissement de la croissance de la productivité agricole mondiale. L’agriculture algérienne reste encore dépendante de l’extérieur, notamment pour certaines cultures stratégiques. Etant donné les difficultés de diverses natures que vivent les pays producteurs, fournisseurs de notre pays, l’impact sur la productivité de ces cultures agricoles stratégiques n’est pas à écarter. Néanmoins, dans notre pays, des avancées significatives dans la production agricole, notamment dans les cultures stratégiques, ont été réalisées grâce à une carte agricole élaborée selon des critères scientifiques et à la poursuite de l’établissement de partenariats internationaux dans le secteur agricole avec des pays leaders dans les filières stratégiques, comme le lait et les céréales. Mieux, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réitéré l’un de ses engagements pris lors de la campagne électorale de la présidentielle du 7 septembre à atteindre l’autosuffisance pour certaines cultures stratégiques, en 2025 et 2026. Le président de la République s’est également engagé à étendre les surfaces irriguées de près de un million d’hectares. Le principe des cultures stratégiques, faut-il l’expliquer, consiste à remplacer les produits importés par des produits nationaux afin d’assurer l’équilibre de la balance commerciale et réaliser le développement social et économique. Près de 10 milliards de dollars sont consacrés annuellement pour répondre à la demande d’un marché local en pleine croissance, sachant que le développement de ces cultures devient plus que stratégique.
Plan d’action du gouvernement
Pour cela, le gouvernement a conçu un plan d’action pour le développement de six cultures stratégiques, à savoir les céréales, les légumineuses, les oléagineuses et betteraves sucrières, le lait, multiplication des semences. Le plan élaboré sur les orientations du président de la République vise l’augmentation de la production nationale de ces produits, dont l’importation continue de peser lourdement sur le Trésor public. Afin d’améliorer la sécurité alimentaire et alléger la facture d’importation, le développement agricole cible ainsi ces filières stratégiques. Outre le nord du pays qui contribue à l’offre nationale, l’Etat recourt aussi au développement de l’agriculture saharienne qui peut assurer jusqu’à 50% des besoins nationaux, avec la création de grands périmètres irrigués bénéficiant des importantes réserves d’eaux phréatiques. Par ailleurs, l’Office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes (ODAS) a été créé dans le but de stimuler les investissements en facilitant l’accès aux terres et en offrant aux investisseurs un guichet unique pour soutenir le développement de cultures stratégiques. Ce plan prévoit, également, la création d’unités de production agricole, après la restructuration d’exploitations agricoles pilotes, dédiées à la production et au développement de filières stratégiques (légumineuses, multiplication de semences, oléagineux et arbres résistant au changement climatique), d’une superficie arable totale de
114.393 ha. C’est dans ce sillage que des mesures importantes ont été prises afin de développer l’agriculture saharienne, dont les superficies pouvant être mises en valeur, dépassent le 1,5 million d’hectares. Ce qui constitue un atout et une opportunité pour l’Algérie d’augmenter ses capacités de production et de renforcer sa sécurité alimentaire. C’est, aussi, un véritable défi à relever, notamment, durant cette conjoncture instable, dont les sources d’approvisionnement deviennent de plus en plus difficiles.
Superficie disponible et renforcement des capacités de stockage
Pour ce faire, une superficie totale de 458.823 ha a été transférée à l’ODAS, répartie sur 54 zones, dont 46 ont déjà été octroyés à des investisseurs. En outre, des mesures incitatives ont été décidées en faveur des agriculteurs, des opérateurs économiques pour développer des filières agricoles à valeur ajoutée. Le plan national de développement de l’agriculture stratégique s’appuie, en outre, sur un programme d’expansion des capacités de stockage, qui comprend la construction de 350 centres de proximité d’une capacité estimée à 1,750 million tonnes de céréales et la relance du projet de construction de 16 silos, en plus de la construction de 30 nouveaux silos d’une capacité de globale de 3 millions de tonnes de céréales. Grâce aux mesures prises par le gouvernement et aux avantages accordées par l’Etat en matière d’investissement, notamment la création d’un couloir vert pour les investissements dépassant les 10.000 ha, le secteur agricole a amélioré son attractivité et capte de plus en plus d’investisseurs nationaux et étrangers. L’année 2024 a été particulière pour ce secteur stratégique avec l’aboutissement de deux projets de grande envergure qui viendront renforcer davantage la sécurité alimentaire et créer une valeur ajoutée pour l’économie nationale. C’est le cas du lancement du mégaprojet en partenariat avec les Qataris pour la production de la poudre de lait et l’augmentation des capacités de production en viande rouge. Le mois d’avril dernier, un accord-cadre a été signé entre le ministère de tutelle et la société qatarie Baladna pour un projet d’un investissement intégré de production de lait en poudre dans la wilaya d’Adrar. Ce projet ambitieux, couvrant 117.000 ha, inclura des fermes d’élevage de vaches laitières, des unités de production de céréales et de fourrages et une usine de production de lait en poudre. D’une valeur de 3,5 milliards de dollars, ce partenariat prévoit la création de 5.000 emplois directs. Une fois achevé, il permettra de couvrir 50% des besoins nationaux en poudre de lait, à l’horizon 2030, tout en augmentant l’approvisionnement en viande rouge et renforçant le cheptel bovin national. Avec le même partenaire, le département de Youcef Cherfa a signé, au mois de septembre dernier, trois accords dont le premier porte sur un document permettant la signature d’un contrat de partenariat entre la société qatarie et le Fonds nationale d’investissement (FNI) afin d’inclure la production du lait infantile dans le projet intégré de production de lait en poudre. Le deuxième accord concerne le pacte d’actionnaires qui a été signé entre la société qatarie Baladna et le FNI, et ce, dans le cadre du projet intégré de production de lait en poudre dans la wilaya d’Adrar. Quant au troisième, il concerne un protocole d’accord, qui a été signé entre le ministère de l’Industrie et de la Production pharmaceutique et Baladna pour la réalisation d’un complexe intégré de production de lait infantile.
Investissement et partenariat étranger : un levier pour la sécurité alimentaire
Il est à noter que le secteur agricole attire l’investissement étranger et se renforce grâce à des partenariats stratégiques en Algérie. De nombreux investisseurs étrangers y voient un potentiel important de développement. Cette dynamique s’inscrit dans le cadre de la politique de coopération internationale mise en place par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, qui considère le partenariat économique comme un levier essentiel pour moderniser et valoriser le secteur. La coopération internationale dans ce domaine vise principalement à renforcer les capacités techniques et technologiques du secteur agricole algérien, notamment par le biais de transfert de savoir-faire, de formation et d’innovation technologique. Elle se matérialise sous forme de partenariats économiques, destinés à maîtriser les procédés de production et de valorisation des produits agricoles, afin d’ajouter de la valeur dans un marché de plus en plus compétitif et globalisé. L’engouement des investisseurs étrangers pour venir investir en Algérie est réel, estime l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI). Selon un bilan arrêté au 30 septembre dernier, quatre projets d’investissement étranger sont inscrits au sein de cette agence dans le secteur agricole, représentant un montant d’investissement global de 2,9 milliards de DA avec un nombre d’emplois prévisionnels déclarés de l’ordre de 244. Ces investissements proviennent de partenaires égyptiens, mauriciens, turcs et syriens. Parmi ces projets, on compte un investissement direct étranger (IDE) et trois en partenariat. Une fois matures, ces projets viendront s’ajouter à ceux qui sont déjà engagés et qui entrent dans la phase d’exécution
Renforcer les cultures stratégiques
Le 6 juillet dernier, un autre accord majeur a été conclu avec la société italienne Bonifiche Ferraresi (BF) pour un projet intégré de production de céréales et de légumineuses dans la wilaya de Timimoun. Le projet, d’une valeur de 420 millions d’euros, s’étend sur 36.000 ha et inclut la production de blé et de lentilles, haricots secs et pois chiches, ainsi que la construction d’unités de transformation pour la fabrication de pâtes alimentaires. Ce partenariat vise non seulement à renforcer l’autosuffisance alimentaire de l’Algérie en matière de céréales et de légumineuses, mais aussi à créer plus de 6.700 emplois, dont 1.600 permanents. En outre, il permettra d’augmenter les exportations de produits transformés, telles que les pâtes alimentaires, contribuant ainsi à diversifier les exportations hors hydrocarbures de l’Algérie. Ces partenariats étrangers, qu’ils soient avec le Qatar ou l’Italie et bien même avec d’autre, illustrent l’intérêt croissant pour le secteur agricole. Ils s’inscrivent dans le cadre du Plan national de développement des cultures stratégiques, qui vise, d’ici à 2027, à atteindre l’autosuffisance en céréales et à diversifier les cultures sur plus de 500.000 ha de terres agricoles dans le Sud.
Exportations
L’autre aspect et non des moindres qui doit être mis en avant dans cette stratégie gouvernementale a trait aux exportations agricoles. Ces dernières années, l’Europe a vu un afflux de produits alimentaires originaires d’Algérie. Cette augmentation des exportations agricoles algériennes échappe non seulement à la dynamique du marché, mais souligne également le rôle croissant du pays dans les chaînes mondiales d’approvisionnement alimentaire. Les facteurs qui contribuent à cette tendance sont multiples, englobant les réformes agricoles stratégiques, les accords commerciaux favorables et la demande croissante de produits alimentaires divers sur les marchés européens. L’Algerie a toujours été connu pour son riche patrimoine agricole, mais ce n’est qu’au cours de la dernière décennie que le pays a considérablement modernisé son secteur agricole.
Réformes et innovations stratégiques
Le gouvernement algérien a mis en œuvre une série de réformes visant à stimuler la productivité et la durabilité de l’agriculture. Il s’agit de l’investissement dans l’infrastructure, c’est-à-dire les systèmes d’irrigation modernes, installations d’entreposage améliorées et réseaux de transport développés améliorés ayant contribué à réduire les pertes après la récolte et à améliorer la qualité des exportations. Sur le plan de la technologie, l’Algérie a adopté des techniques d’élevage avancées, y compris l’agriculture de précision et l’utilisation de variétés végétales à haut rendement qui ont permis d’accroître l’efficacité et la production. A cela, l’on ajoute les initiatives visant à soutenir les petites et moyennes entreprises par des subventions, des programmes de formation et l’accès au crédit qui ont permis aux agriculteurs locaux de contribuer de façon significative au marché des exportations. Par ailleurs, l’emplacement géographique stratégique de l’Algérie, un pays de transition entre l’Afrique et l’Europe, a facilité l’établissement d’accords commerciaux avantageux avec, entre autres, les pays européens.
B. K.