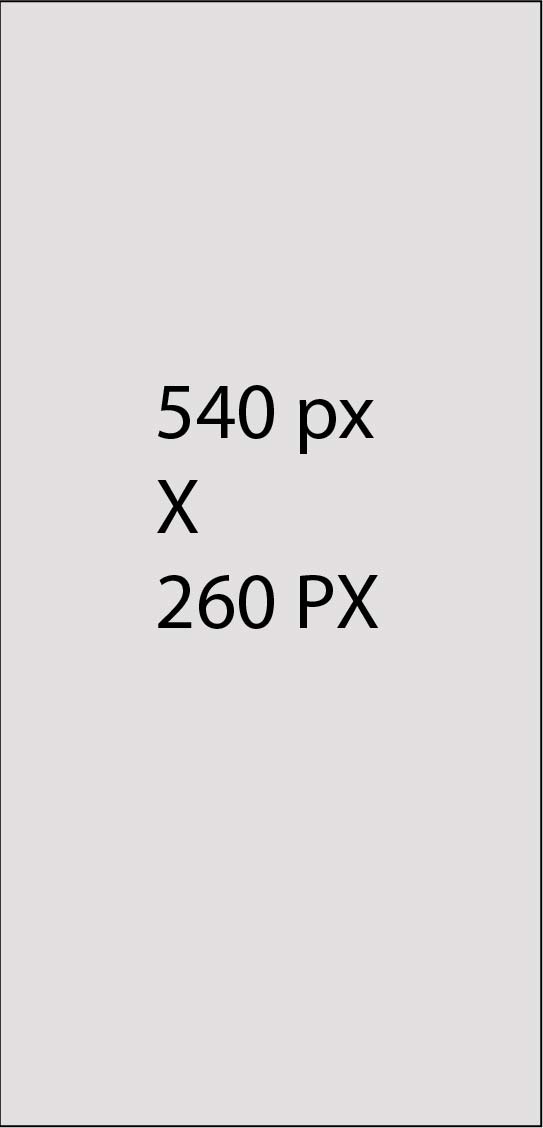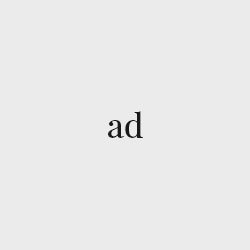Depuis plusieurs mois, la crise entre la France et l’Algérie fait la une de l’actualité. Spécialiste de l’histoire du Maghreb contemporain, Benjamin Stora, professeur émérite des universités, a souligné dans un entretien accordé au quotidien français «Libération» que la suspension du journaliste Jean-Michel Aphatie après ses propos sur les crimes coloniaux en Algérie illustre le danger qui menace les chercheurs lorsqu’ils établissent des vérités historiques.
En commentant la suspension du journaliste français, l’historien n’a, en réalité, fait que confirmer le déni de la France, refusant catégoriquement de reconnaître ses crimes commis durant plus d’un siècle en Algérie, mais aussi d’intimider toutes les personnes et les voix qui s’élèvent pour évoquer la question des mémoires.
«L’histoire coloniale de la France est encore un sujet tabou dans certains cercles politiques et médiatiques. Il existe une résistance à la reconnaissance des crimes commis en Algérie, notamment durant la conquête et la guerre d’indépendance», affirme l’historien.
La brutalité de la conquête coloniale française est une réalité longtemps passée sous silence. Dès 1830, l’armée française mène une guerre d’anéantissement, caractérisée par des massacres, des pillages et des destructions massives.
Parmi les faits les plus emblématiques figurent les enfumades des grottes du Dahra en 1845, où des centaines de réfugiés, principalement des femmes et des enfants, ont été asphyxiés par la fumée, ainsi que le siège de Constantine en 1837, qui a causé de nombreuses pertes civiles même après la prise de la ville.
En 1852, la ville de Laghouat est anéantie, faisant 2.500 morts. En 1871, la répression du soulèvement kabyle entraîne la confiscation de
500.000 ha de terres et l’exil de nombreux habitants. Ces actes, qui ont fait des milliers de victimes civiles, s’inscrivent dans une logique d’extermination coloniale.
Jean-Michel Apathie, en comparant ces massacres aux crimes nazis à Oradour-sur-Glane en 1944, a provoqué une polémique. L’analogie avec le nazisme peut prêter à débat, mais elle met en lumière l’ampleur des violences coloniales et leur occultation dans la mémoire collective française, estime l’historien, rappelant que Hannah Arendt avait déjà souligné que l’impérialisme européen avait servi de laboratoire aux doctrines raciales et aux politiques bureaucratiques qui nourriront plus tard le totalitarisme. Cependant, dit-il, il est important de rappeler qu’en 1830, la France ne poursuivait pas un projet d’extermination raciale, un concept qui émergera plus tard dans l’histoire.
Les historiens empêchés d’accéder à certaines archives
La suspension de Jean-Michel Apathie est perçue comme une tentative de restreindre la critique historiographique. Le journaliste a affirmé une vérité historique, ce qui lui a valu une vague d’attaques et d’insultes.
«Nous assistons à une crispation autour de la mémoire coloniale. Dès que l’on met en lumière certaines vérités, il y a une levée de boucliers. Cette attitude empêche un véritable travail de mémoire», explique Benjamin Stora.
Cet épisode illustre la difficulté de travailler sereinement sur les thèmes du colonialisme et de l’esclavage, explique encore Stora. La liberté de la recherche est menacée, comme en témoignent les attaques contre les travaux universitaires sur ces sujets, notamment en raison des polémiques sur le supposé «wokisme». La France peine toujours à assumer pleinement son passé colonial.
Cette difficulté repose en partie sur le fait que la conquête coloniale française a été justifiée par une «mission civilisatrice» plutôt que par une idéologie de supériorité raciale. Cette rhétorique, ancrée dans la pensée des Lumières, a nourri une bonne conscience collective et empêché toute remise en question profonde.
Contrairement aux États-Unis, qui ont mis en scène la conquête de l’Ouest et ses violences, la France n’a jamais porté à l’écran la conquête sanglante de l’Algérie et les massacres qui l’ont accompagnée. Si de nombreux historiens ont documenté ces crimes, leur travail a longtemps été interrompu après les indépendances. Une fois les empires démantelés, la France a préféré refermer la parenthèse coloniale plutôt que d’en analyser les conséquences.
Ce n’est qu’à partir des années 2000 qu’un retour de mémoire a commencé, avec l’ouverture d’archives et des études approfondies sur la colonisation. Ce mouvement a néanmoins suscité des réactions hostiles, notamment de la part de courants politiques qui dénoncent le wokisme pour freiner toute remise en question du récit national traditionnel. Pour lever le tabou et favoriser une meilleure reconnaissance historique, des actes concrets sont nécessaires.
La reconnaissance officielle de l’assassinat de figures de la lutte pour l’indépendance comme Maurice Audin, Ali Boumendjel et Larbi Ben M’hidi par Emmanuel Macron a constitué un premier pas, mais reste insuffisante. «Les gestes symboliques sont importants, mais ils doivent être suivis d’actes concrets, notamment en matière de restitution et d’accès aux archives», insiste Benjamin Stora.
Des gestes forts, comme la restitution d’objets historiques tels que les livres, les étendards et le Coran personnel de l’émir Abdelkader, seraient une avancée significative. Une loi de restitution pourrait également être envisagée.
Un travail de mémoire partagé entre la France et l’Algérie semble aujourd’hui compromis en raison des tensions diplomatiques entre les deux pays. La commission mixte d’historiens, qui s’était réunie à plusieurs reprises entre 2023 et 2024, ne fonctionne plus. La mémoire de la colonisation reste un enjeu identitaire majeur, en particulier pour les nouvelles générations qui cherchent à se réapproprier cette histoire. Aucun discours idéologique en France ne pourra empêcher cette quête de vérité, notamment chez les historiens qui n’arrêtent pas de mettre à jour la réalité coloniale dans toute sa sauvagerie et inhumanité.
Larbi A.