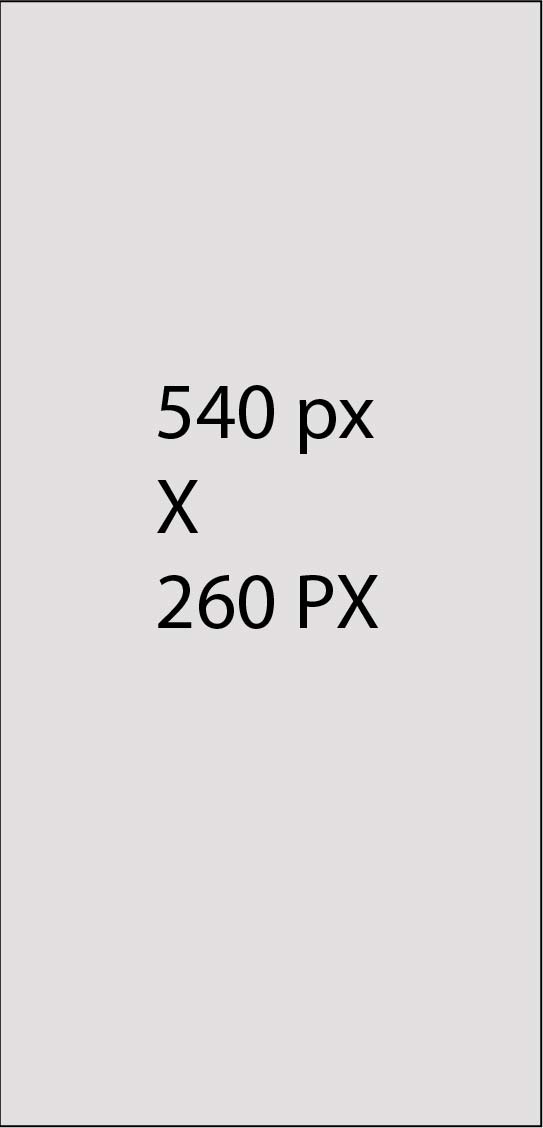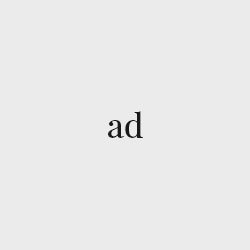La grotte est peu connue. Elle est zappée, peut-être par méconnaissance, par les opérateurs du secteur du tourisme. Elle ne figure, à notre connaissance, dans aucune brochure, aucun prospectus, dépliant et circuit proposés aux éventuels clients.
Elle est pourtant entourée de plusieurs merveilleux sites, très fréquentés pour certains d’entre eux. C’est le cas notamment du Jardin d’essai du Hamma, du Musée national des beaux-arts, de la villa Abdelatif, du sanctuaire du Martyr, des deux musées de l’Armée et du Moudjahid de Riadh El-Feth et, enfin, du mausolée de Sidi M’hamed Bou-Qobrine (l’homme aux deux tombeaux).
Elle est située sur le boulevard portant le nom de Miguel de Cervantès Saavedra. Elle est creusée dans la roche, à deux mètres du sol d’une plate-forme sur laquelle est édifiée une stèle en marbre blanc, à la mémoire de l’auteur de Don Quichotte de la manche. Un texte gravé sur la stèle résume la biographie du Manchot de Lépante et son «séjour» en captivité à Alger, sous l’occupation ottomane (1516/1830).
L’excavation se trouve sur un terrain pentu en tuf appartenant à Caïd Hassan, un janissaire d’origine grecque. Elle a été percée par un captif navarrais, Juan, employé comme jardinier chez le dignitaire ottoman. Elle a servi de casemate pour Cervantès et quatorze autres captifs. Ils se préparaient à s’enfuir à bord d’un navire qui devait venir d’Espagne les récupérer. Leurs quatre tentatives d’évasion ont échoué. Le premier navire rebroussa chemin après avoir été découvert par les Janissaires.
La grotte surplombée d’un petit belvédère dominant la plage des Sablettes, endroit réputé pour avoir été le cimetière de l’armada de Charles-Quint en 1541. L’ultime tentative de l’Empereur d’Espagne d’occuper Alger et de coloniser l’Algérie avait tourné en tragédie indescriptible le 25 octobre de la même année. Son armée comptant plus de cinq-cents navires, montés par 12.000 matelots et 22.000 hommes de troupes, avait été presque entièrement décimée par… la tempête. Les rescapés avaient subi de grosses pertes sur les chemins vers Cap Matifou où s’étaient réfugiés les navires épargnés par la tourmente du port d’Alger.
Ouali Dada-Bouguedour contre Charles-Quint
La légende populaire attribue la déroute de Charles-Quint à quatre saints de la ville, dont Sidi Ouali Dada et Sidi Bouguedour. Dès l’arrivée des troupes espagnoles sur la baie, les deux saints hommes descendirent au port. Le premier souleva une grande tempête en remuant l’eau du port avec sa canne magique. Chacun de ses mouvements faisaient couler un ou plusieurs navires. Le deuxième, montait sur un bateau transportant de la poterie, provoque la destruction d’un navire chaque fois qu’une poterie jetée à terre volait en morceaux. Les janissaires ne s’étaient lancés aux trousses des rescapés espagnols qu’après leur mise en déroute par la tempête.
Miguel de Cervantès, un officier de l’armée d’Espagne, a été débarqué à Alger le 28 septembre 1575 avec de nombreux autres captifs des deux sexes, dont son frère Rodrigo. Ils ont été interceptés par des corsaires ottomans commandés par Arnaut Mami, d’origine albanaise. Venant de Naples (Italie) d’où elle avait pris le large le 20 du même mois, la galère El Sol sur laquelle il voyageait se dirigeait vers l’Espagne. Elle avait été arraisonnée et prise d’assaut par des janissaires que commandait Dali Mami, d’origine grecque. «D’une audace peu commune, il (Dali Mami) semait la terreur sur les côtes espagnoles, qu’il parcourait jusqu’à Gibraltar (…). Il avait un caractère assez humain et ne maltraitait pas les chrétiens», selon une étude publiée dans le Bulletin de la société de géographie d’Alger et de l’Afrique du Nord (1924).
L’auteur de Don Quichotte fut désarçonné. «Quand j’arrivai, vaincu et que je vis cette terre si fameuse en tous lieux, qui accueille en son sein et protège tant de pirates, je ne pus me contenir et des pleurs, malgré moi, inondèrent mon visage défait», écrivait-il, selon ce bulletin.
Miguel de Cervantès est né en octobre 1547 à Alcala de Henares (Espagne). Il est mort le 22 avril 1616, à l’âge de 69 ans. Il n’avait que 28 ans lorsqu’il a été capturé. Il avait été libéré le 24 octobre 1580, après le paiement d’une importante rançon de 500 écus or, réunie par sa famille et des amis. Durant sa captivité de cinq ans à Alger, il était maltraité par ses geôliers. «Jamais Hassan (Pacha) ne lui donna des coups de bâton, ni ne lui fit donner, ni ne lui adressa de mauvaises paroles», écrivait-il dans «Le récit d’un captif». Comme d’autres prisonniers, ils vadrouillent facilement à travers les deux grandes artères d’Alger de l’époque, à savoir les rues Bab-Azoun et Bab El-Oued, selon l’hebdomadaire Annales africaines (29/02/1924).
La grotte mérite un détour
Miguel de Cervantès avait perdu un bras lors d’une bataille contre des Janissaires à Lépante, en Grèce, le 7 octobre 1571. Depuis, on l’appelait «le manchot de Lépante». Il écrira plus tard «bienheureux les siècles qui ne connaissent point la furie épouvantable de ces instruments endiablés de l’artillerie, dont je tiens que l’inventeur aura reçu en enfer le prix de son invention démoniaque».
Le premier hommage lui avait été rendu en 1887. La communauté espagnole établie à Alger avait placé une plaque commémorative en marbre, aujourd’hui disparue, à l’entrée de la grotte, sur laquelle on pouvait lire : «Cueva refugia que fue del autor del Quijote, año 1577» (grotte qui fut le refuge de l’auteur de Don Quichotte, en 1577). Une commission composée de spécialistes, mise en place en février de la même année (1887) avait confirmé que la grotte en question était celle de Cervantès, en se basant sur les écrits de l’époque.
Son buste placé le 24 juin 1897 près de sa grotte avait été remplacé par la stèle actuelle. Celle-ci a été érigée en 1926 sur la plate-forme sur laquelle épanouissent quelques arbres, dont un oléastre et un palmier nain, ombrageant quatre bancs en bois.
En 2004, la Bibliothèque nationale d’Algérie avait organisé une soirée poétique devant la grotte. L’année suivante, Algérie-Poste émettra un timbre poste à l’effigie de Miguel de Cervantès. La grotte est ouverte aux visites après des travaux de restauration réalisés par l’Institut Cervantès d’Alger.
Son livre Don Quichotte de la manche avait fait un tabac et continuait de se vendre. Depuis sa publication en 1605, l’ouvrage avait été édité 1369 fois, dont 431 éditions en espagnol, 285 en français, 241 en anglais et 117 en allemand (statistiques de 1937). Il avait été traduit dans plusieurs dizaines d’autres langues à travers le monde.
Le succès de Don Quichotte viendrait peut-être du fait que son auteur l’ait rédigé «en un lieu où toute incommodité a son siège, où tout bruit lugubre fait sa demeure», écrira-t-il dans la première partie de l’ouvrage. Malgré ce cadre funeste, «j’ai par Don Quichotte procuré un divertissement aux cœurs mélancoliques et aux esprits chagrins», soulignera-t-il dans «Voyage au Parnasse» (1614).
Interrogé par des diplomates français sur ce qui était advenu de Miguel de Cervantès, un religieux chargé de lire la seconde partie de Don Quichotte avant la délivrance de l’autorisation d’impression, répond qu’il était vieux, hidalgo (noble) mais pauvre.
«Comment se fait-il que l’Espagne ne donne pas à un tel homme l’aisance et même la richesse ?», s’interrogeait un des diplomates. «Mais un autre de ces messieurs dit avec beaucoup de finesse : si c’est le besoin qui le pousse à écrire, plaise à Dieu qu’il ne devienne jamais riche, pour que, en restant pauvre, il enrichisse le monde entier de ses œuvres», rapportait Martial Douël dans son livre «L’héroïque misère de Miguel de Cervantès, esclave barbaresque» (1930).
Mohamed Arezki Himeur