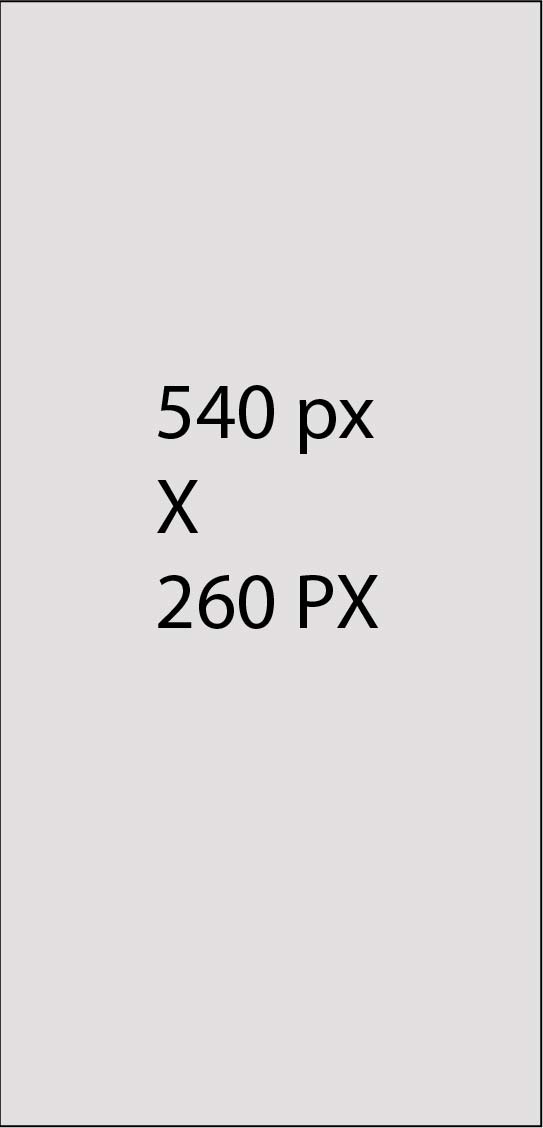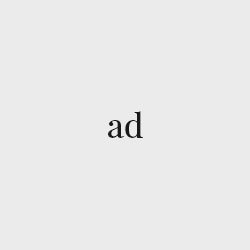L’un des points forts du documentaire réside dans les témoignages des derniers survivants de cette guerre, tant du côté français que du côté algérien. En révélant l’usage d’armes chimiques par l’armée française, Claire Billet et Christophe Lafaye brisent un silence de plusieurs décennies et offrent une nouvelle perspective sur ce conflit. Le film, à la fois historique et mémoriel, invite à une réflexion sur les conséquences de la guerre coloniale et les responsabilités de l’Etat français.
Le documentaire «Algérie, sections armes spéciales», réalisé par Claire Billet et produit par Solent Production, promet de lever le voile sur l’un des chapitres les plus sombres et méconnus de l’histoire coloniale française. Attendu pour le 16 mars 2025 sur France 5, ce film de 52 minutes révèle pour la première fois à la télévision l’usage systématique d’armes chimiques par l’armée française pendant la guerre d’Algérie (1954-1962). À travers des archives inédites, des témoignages poignants et des recherches historiques approfondies, le documentaire explore une réalité longtemps occultée. Le documentaire «Algérie, sections armes spéciales» vient de casser un tabou et révèle au grand jour aussi clairement que possible que «l’armée française a utilisé des gaz toxiques pour éliminer les combattants algériens retranchés dans les grottes».
La guerre d’Algérie reste l’un des conflits les plus douloureux et complexes de l’histoire française. Si les pratiques de torture, les déplacements forcés de populations et les exécutions sommaires ont été progressivement documentés, l’usage d’armes chimiques est resté un sujet tabou, enfoui dans les archives militaires et les mémoires silencieuses. Claire Billet, journaliste et réalisatrice spécialisée dans les questions de guerre et de mémoire, s’est attaquée à ce silence d’État avec l’aide de l’historien Christophe Lafaye. Ensemble, ils ont mené une enquête minutieuse pour «reconstituer les faits» et «donner la parole aux derniers témoins de cette guerre chimique».
Le film s’appuie sur les recherches inédites de Christophe Lafaye, qui a passé des années à fouiller les archives militaires et à recueillir des témoignages d’anciens combattants français et algériens. Ces recherches ont permis de mettre en lumière l’existence de sections spéciales de l’armée française chargées de tester et d’utiliser des armes chimiques, notamment des gaz toxiques, pour déloger les moudjahidine du FLN (Front de libération nationale) retranchés dans les grottes des régions montagneuses de Kabylie et des Aurès.
Une guerre chimique dans l’ombre
Le documentaire dévoile comment, dans le cadre de cette guerre coloniale, l’armée française a franchi «une ligne rouge» en utilisant des armes chimiques, «en violation des conventions internationales». Les gaz toxiques étaient principalement employés pour «asphyxier les combattants algériens cachés dans des grottes», rendant ces armes particulièrement efficaces dans les zones montagneuses difficiles d’accès. Les opérations chimiques étaient menées dans le plus grand secret, sans laisser de traces visibles et les masques à gaz, les combinaisons de protection et les munitions chimiques n’apparaissent jamais dans les films ou les photographies officielles de l’époque.
Claire Billet et Christophe Lafaye ont retrouvé des documents administratifs militaires qui attestent de «l’existence de ces opérations». Malgré les refus opposés par le Service historique de la défense, les archives nationales
françaises ont permis de confirmer l’ampleur de cette «guerre chimique». Les témoignages des anciens combattants français et algériens, ainsi que ceux des experts en armes nucléaires, biologiques et chimiques, viennent compléter ce tableau glaçant. Ces récits, souvent difficiles à entendre, décrivent «l’horreur des attaques chimiques et leurs conséquences dévastatrices sur les populations locales».
Des témoignages bouleversants
L’un des points forts du documentaire réside dans les témoignages des derniers survivants de cette guerre, tant du côté français que algérien. En France, les anciens combattants qui ont accepté de parler ont ouvert leurs archives personnelles, échappant ainsi à la censure officielle. Leurs récits, souvent teintés de culpabilité et de honte, révèlent «les ordres reçus» et «les méthodes employées pour éliminer les combattants algériens». Du côté algérien, les témoignages des victimes et de leurs familles rappellent «l’impact durable de ces attaques chimiques sur les communautés locales».
Le film montre également comment «cette guerre chimique s’inscrit dans un contexte plus large de violations des droits de l’homme et des conventions internationales». Avec la torture et les déplacements forcés de populations, «l’usage d’armes chimiques constitue l’un des aspects les plus sombres de la guerre d’Algérie». Claire Billet souligne que «ces pratiques ont été systématiquement occultées par les autorités françaises, qui ont cherché à effacer toute trace de ces opérations».
Une enquête contre les silences de l’Histoire
Le travail de Claire Billet et de Christophe Lafaye est d’autant plus remarquable qu’il a été mené malgré les obstacles institutionnels et les silences officiels. Les archives militaires relatives aux armes chimiques ont été soigneusement cachées, et les demandes de tournage au Service historique de la défense ont été refusées. Pourtant, grâce à la persévérance des chercheurs et à l’ouverture des archives nationales, le documentaire parvient à reconstituer une partie de cette histoire occultée.
Le film ne se contente pas de révéler des faits historiques. Il interroge également la mémoire collective et la manière dont la France a géré l’héritage de cette guerre. En donnant la parole aux témoins et en confrontant les archives aux récits des survivants, «Algérie, sections armes spéciales» invite à «une réflexion sur les conséquences à long terme de la guerre coloniale» et sur « les responsabilités de l’État français».
Claire Billet, une réalisatrice engagée
Claire Billet, qui signe ici un documentaire puissant et nécessaire, est une journaliste et réalisatrice reconnue pour son travail sur les conflits et leurs conséquences. Depuis plus d’une décennie, elle explore les thèmes de la guerre, de la mémoire et des injustices, avec une attention particulière portée aux voix des victimes et des témoins. Parmi ses précédents travaux, on retrouve des documentaires sur l’Afghanistan, la Syrie et l’Iran, où elle a toujours cherché à donner la parole à ceux qui sont trop souvent réduits au silence.
Dans «Algérie, sections armes spéciales», elle poursuit cette démarche en mettant en lumière «une page sombre de l’histoire française», tout en interrogeant «les silences» et «les tabous» qui entourent encore aujourd’hui la guerre d’Algérie. Son travail, soutenu par des recherches historiques rigoureuses et une mise en scène sobre et efficace, permet au spectateur de saisir l’ampleur et la complexité de cette guerre chimique.
«Algérie, sections armes spéciales» est un documentaire essentiel, qui vient combler un vide dans l’historiographie de la guerre d’Algérie. En révélant l’usage d’armes chimiques par l’armée française, Claire Billet et Christophe Lafaye brisent un silence de plusieurs décennies et offrent une nouvelle perspective sur ce conflit. Le film, à la fois historique et mémoriel, invite à une réflexion sur les conséquences de la guerre coloniale et sur les responsabilités de la France.
Sa diffusion sur France 5, le 16 mars prochain, marquera sans doute un tournant dans la manière dont la société française aborde son passé colonial. En jetant la lumière sur un sujet aussi explosif que méconnu, ce documentaire contribue à une meilleure compréhension de l’histoire et à une reconnaissance des souffrances endurées par les victimes de cette guerre.
Yanis Aït-Lamara