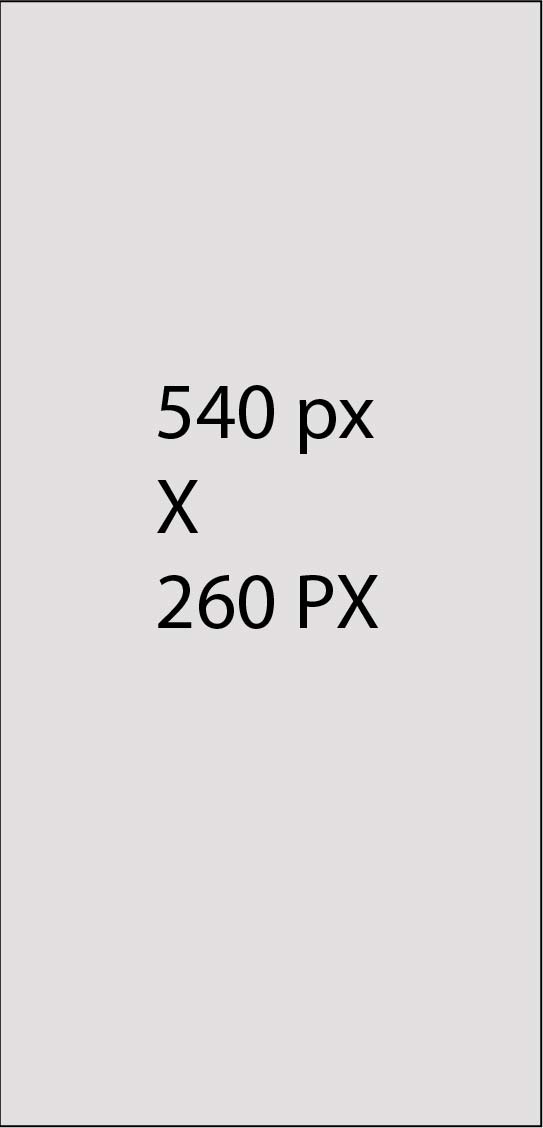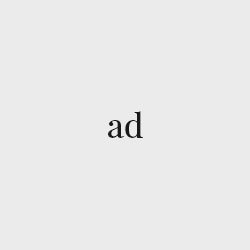La Grande-Poste est un magnifique édifice néo-mauresque inauguré en 1913. Elle ne laisse aucun touriste et passager indifférent. Occupant une superficie de 2.800 m2, elle abrite deux centraux téléphoniques et une multitude de services d’Algérie Poste et d’Algérie Télécom. Une véritable fourmilière.
Le hall central, réservé autrefois au public, est vidé des différents services et de leur personnel. Il sera érigé en Musée national de la poste algérienne. Le site est inoccupé depuis plusieurs années déjà, mais les travaux de son agencement en musée n’ont pas encore commencé.
Il est vrai que ce vaste hall s’y prête fort bien pour une telle activité. Le futur musée est de nature à drainer un grand nombre de visiteurs. D’autant qu’il est situé en plein cœur de la capitale, dans un endroit très fréquenté par les habitants de la ville, mais aussi des touristes et des voyageurs. Il l’est encore davantage depuis que le quartier a subi quelques aménagements caractérisés par la création d’espaces réservés aux piétons, de cafés et de restaurants sur le parcours reliant la Grande-Poste et la place Maurice Audin.
La Grande-Poste est construite dans le style néo-mauresque. Elle compte cinq façades. Chacun de leurs accès est affecté à un service ou à une activité différente : l’entrée principale mène vers le hall, l’entrée pour la réception des télégrammes de nuit, l’entrée des services de l’administration, l’entrée des appartements et l’entrée du personnel et des voitures. Les gigantesques portails en bois de ce dernier accès, donnant sur la rue Asselah-Hocine, constituent, à eux seuls, un objet de visite.
L’entrée principale du futur musée est enchâssée entre deux tourelles, coiffées au sommet par deux coupoles éloignées l’une de l’autre de 26 m. On accède dans le hall, haut de 13 mètres, par l’un des trois arcs du large escalier de 17 marches à deux paliers, séparés par quatre colonnes en granit.
Richesse architecturale
Le visiteur est accueilli, au deuxième et dernier palier, par trois monumentales portes en bois sculpté. La spacieuse salle, qui s’étend sur 500 m2, est construite en demi-cercle avec, au centre du plafond, un immense dôme par lequel entre la lumière du jour. Les plafonds sont soutenus par deux rangées de colonnes en granit. Les murs et les plafonds sont richement décorés en stucs et en arabesques, faisant de l’édifice un véritable joyau architectural et artistique. Son style rappelle, dit-on, celui de l’Alhambra, en Espagne. Les architectes, Jules Voinot et Marius Toudoire, avaient promis que le hall de la Grande-Poste «sera d’une grande richesse architecturale». Ce qui fut fait.
Le plan initial de l’Hôtel des postes a été revu. Il a été «amputé» d’un long minaret de 70 m de hauteur. Celui-ci devait servir de support à une imposante horloge, dont chacun des quatre cadrans devait mesurer sept mètres de diamètre. L’horloge devait être visible de tous les coins de la ville. Ainsi, «le promeneur qui arpentera la place du Gouvernement (actuelle place des Martyrs) pourra, à la fois, régler sa montre sur l’heure de la mosquée (djamaâ) Djedid et l’heure de l’Hôtel des postes», dira un responsable de la municipalité d’Alger, lors de la présentation du plan élaboré par le duo d’architectes Voinot et Toudoire.
La Grande-Poste a été construite sur l’emplacement d’un cimetière et une église anglicane datant de 1870, acheté par la France en 1906. Les ossements des morts et les équipements du lieu de culte avaient été transférés à l’Eglise anglicane inaugurée en 1909 dans le quartier de Mustapha Supérieur. La bâtisse existe encore. Elle se trouve dans une sorte de palais occupé autrefois par l’ambassade du Royaume-Uni, au rond-point de la place Addis-Abeba, à Alger. Elle a été bâtie dans le style néo-mauresque par un architecte français, Henri Petit.
L’ancienne église et le cimetière dont les terrains furent cédés aux Français étaient édifiés, eux aussi, sur les ruines des fortifications de Ras-Tafourah, qu’on appelait également au temps de l’occupation ottomane, Fort Bab-Azoun. Ce fort avait été construit par Hassan Pacha en 1541, année du cuisant échec du débarquement des troupes de l’empereur d’Espagne Charles-Quint sur les berges des Sablettes. Il avait été détruit par les Français en 1905, soit une année avant le début des travaux de la construction de la Grande-Poste.
Sur les ruines d’une Eglise
Agrandi par Mustapha Pacha en 1798, ce fort avait été transformé en prison à partir de 1816, afin d’«héberger» des officiers français du génie, déportés de leur pays à Alger pour des raisons politiques. L’Algérie était à l’époque sous le joug de la domination ottomane. Après le débarquement des troupes françaises en juin 1830 en Algérie, ce même fort reprit, dès 1848, son ancienne activité de pénitencier militaire.
La Grande-Poste avait été en partie ravagée par un incendie le 18 décembre 2012, jour de la visite officielle du président français François Hollande en Algérie. Son «cortège», qui devait effectuer un détour par cet endroit, avait été dévié.
Cette superbe bâtisse est implantée dans un carrefour sur lequel débouchent plusieurs artères du centre-ville comptant des sites, des édifices et des monuments historiques et touristiques qui méritent un détour. Le boulevard Mohamed Khemisti abrite une belle bâtisse de style néo-mauresque, comprenant une tour carrée, à l’angle de l’avenue Pasteur et du boulevard Mohamed Khemisti. Elle a été construite en 1906. Elle abritait le siège et l’imprimerie de La Dépêche algérienne, puis la rédaction d’Alger Républicain. Elle héberge aujourd’hui une permanence du Rassemblement national démocratique (RND). Elle fait face à l’imposant hôtel Albert 1ᵉʳ, actuellement en rénovation.
L’horloge florale du jardin éponyme, qui perd parfois ses aiguilles, est placée sur le même boulevard Mohamed Khemisti qui dévalait autrefois de l’actuel stade Ouaguenouni jusqu’au rond-point inférieur de la Grande-Poste, près du jardin Sofia.
Au-dessus de l’horloge, sur un terre-plein du même jardin, est édifié en 1928 un monument aux morts de la Première Guerre mondiale. Le mémorial est dédié aujourd’hui, après avoir été soumis à quelques retouches, à la mémoire des martyrs de la lutte de libération nationale (1954-1962).
C’était le 26 mars 1962, huit jours après la signature des accords d’Evian entre la France et le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA). Des soldats français avaient tiré sur des manifestants français hostiles à ces accords. Ceux-ci prévoient un cessez-le-feu dès le 19 mars et l’organisation d’un référendum d’autodétermination dans un délai de trois à six mois.
Le bilan de cette sanglante fusillade n’a jamais été divulgué. Il était évalué à quelque 70 morts et des dizaines de blessés, par certains auteurs.
A. H.