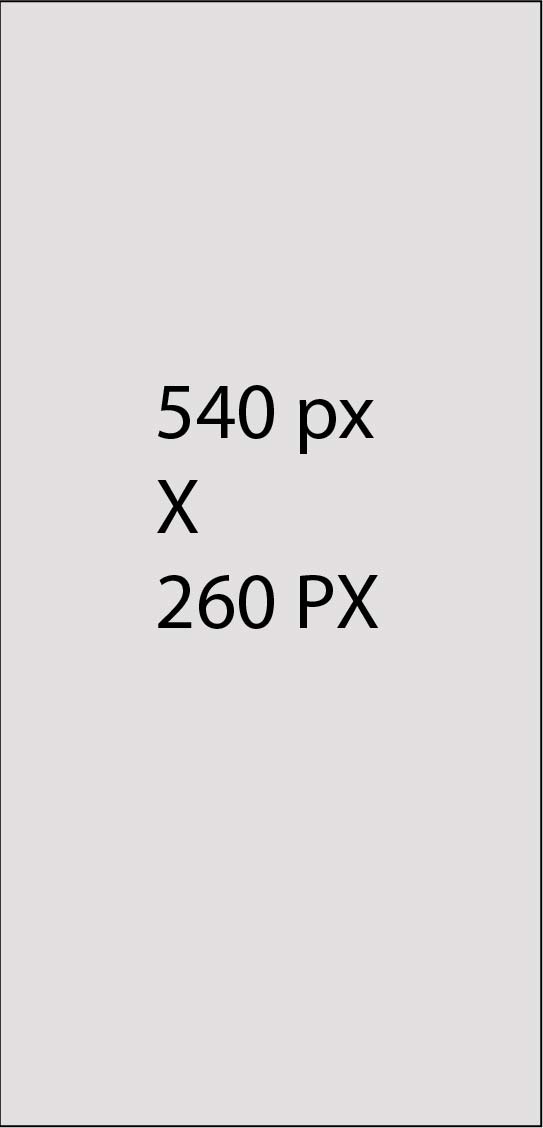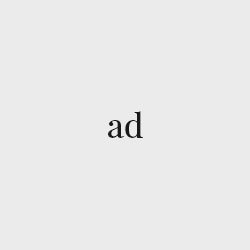Avec ses hauts minarets et la splendeur architecturale de sa façade, la mosquée Ketchaoua s’impose comme la plus remarquable bâtisse de la basse Casbah. Elle est située à la place Abdelhamid Ben Badis, à proximité de la place des Martyrs, de la station de métro du même nom, du marché Amar Elkama (ex- de Chartres). Elle est proche également de Bab Azoun, la principale rue commerçante du Vieil Alger depuis, notamment, le débarquement des Ottomans en 1516 dans la cité des Beni Mezghenna.
Elle se trouve dans un secteur où sont assemblés les principaux palais ottomans. Elle est accolée au palais Hassan Pacha, actuellement en restauration, tandis que dar Aziza ben el-bey lui fait face. C’est à la basse Casbah que sont concentrés l’ensemble des luxueuses résidences ottomanes, alors que les mosquées et les mausolées sont situés dans la partie supérieure de la cité, à la haute Casbah, précisément. C’est de cet endroit, en bas des escaliers de la mosquée Ketchaoua, que commencent les balades touristiques de la Casbah d’Alger. Elles sont animées par des jeunes du quartier, qui ont appris l’activité de guide touristique sur le tas.
C’est ici aussi qu’elles prennent fin, que les guides et les touristes se séparent. Après avoir visité, ou vu de l’extérieur, les autres palais, tels que dar Khedaoudj el-amiya qui abrite le musée national des arts et traditions populaires, dar El Kadi, dar Ahmed Pacha, actuel siège du Théâtre national algérien Mahieddine Bachtarzi, dar Mustapha Pacha abritant le musée national de l’enluminure, de la miniature et de la calligraphie et dar Es-Souf. La majorité des palais et résidences ottomans sont occupés par des offices chargés de la restauration, de la rénovation et de la protection du Vieil Alger.
Mosquée antérieure à l’époque ottomane ?
Dar El-Hamra actuellement en rénovation, le palais des Raïs (ex-Bastion 23) et les mosquées Djedid et El-Kebir se trouvent dans le même secteur de la basse Casbah, qu’on appelait autrefois le quartier de la Marine. Un quartier entièrement rasé durant la colonisation, pour céder la place à des constructions modernes.
Un acte datant de l’occupation turque relève que la mosquée Ketchaoua existait en 1612. Elle fut restaurée par le dey Hassan en 1794-1795. Un récent ouvrage turc, rédigé en turc, note de son côté qu’une mosquée existait déjà, en 1436, dans l’emplacement occupé plus tard par la mosquée Ketchaoua, à partir de 1613 (cf. : Cezayir Gezi Rehberi, Algiers Travel Guide, de Muhsin Kadioglu, 2020). Ce qui signifie que Ketchaoua avait été édifiée, elle aussi, sur les vestiges d’une mosquée antérieure à l’occupation ottomane.
Lors de l’édification de la cathédrale sous le nom de Saint-Philippe, de 1845 et 1860, des ruines romaines y ont été découvertes. Un auteur français avait critiqué la destruction de la mosquée Ketchaoua et son remplacement, sur le même site, par un lieu de culte chrétien. « Et enfin, et surtout la mosquée Ketchaoua, l’édifice le plus élégant de la ville des Maures, quelle idée funeste a-t-on eue de la transformer en cathédrale ? Et quelle cathédrale, bon Dieu ! Un monsieur trop zélé, se disant architecte, a fait, en s’appliquant beaucoup, de ce monument gracieux le monument le plus grotesque. Et ça ne rappelle pas du tout, comme on le dit, l’architecture byzantine, mais tout au plus cet objet d’art que fabriquent les pâtissiers pour les dîners de mariage, et qu’on nomme un gâteau monté » (cf. : Alger, étude, E. Feydeau, 1862). Parlant de l’architecture de la Cathédrale, Marius Bernard, auteur, écrivait que « c’est assez laid en somme, un temple de style indécis, ni musulman, ni chrétien, avec, à l’intérieur, une chaire de marbre rose et quelques arcades en fer à cheval, uniques vestiges de la mosquée disparue » (cf. : Autour de la Méditerranée, les côtes barbaresques d’Alger à Tanger, Marius Bernard, Henri Laurens éditeur, Paris, 1892, volume 3).
Expropriation sanglante
Un hebdomadaire colonial édité en Algérie (L’Effort algérien du 23 décembre 1932), rapportait que la mosquée Ketchaoua fut, « presque spontanément », offerte au gouvernement français par des dignitaires musulmans de la ville. Cette thèse fut battue en brèche plus de deux ans auparavant par Henri Klein, président du Comité du Vieil Alger. Celui-ci avait affirmé que la mosquée avait été prise par la force, que des tirs sur les fidèles barricadés à l’intérieur pour empêcher son expropriation, avaient provoqué une bousculade faisant de nombreuses victimes. «La troupe refoule à la baïonnette les indigènes dans l’intérieur de la mosquée. Ceux-ci fuient par une issue donnant sur la rue du Vinaigre. Plusieurs Arabes gisent sur les tapis, étouffés ou blessés. Toute la nuit, le temple fut occupé par une compagnie d’infanterie. Ainsi s’accomplit la prise de possession de Ketchaoua », relevait-il dans une déclaration citée par la revue La Révolution Prolétarienne (1er mars 1930).
Par cette appropriation violente, la France foula aux pieds la convention de capitulation de la Régence d’Alger, signée le 5 juillet 1830, entre le Dey Hussein et de Bourmont. Cette convention stipule, noir sur blanc, que « L’exercice de la religion mahométane restera libre. La liberté des habitants de toutes classes, leur religion, leurs propriétés, leur commerce et leur industrie, ne recevront aucune atteinte. Leurs femmes seront respectées. Le général en chef en prend l’engagement sur l’honneur. » La suite de cet « honneur », on la connaît sous forme d’horreur. C’est l’épouvante qui fut appliquée sur le terrain durant 132 ans.
La mosquée Ketchaoua, classée monument du patrimoine universel, a été relookée à partir de 2015 par une entreprise turque. Implantée dans un quartier fortement animé et commerçant, à quelques centaines de la place des Martyrs et de la station terminus du métro, elle dispose de tous les atouts pour drainer des touristes et des visiteurs étrangers et algériens. A condition qu’elle ouvre ses portes aux visites, ne serait-ce que deux heures par jour. De préférence la matinée. Elles sont closes pour le moment. On connaît peu de choses sur l’agencement et l’ornementation intérieurs de Ketchaoua, depuis qu’elle est redevenue mosquée au lendemain de l’accession de l’Algérie à l’indépendance en 1962.
M. A. H.