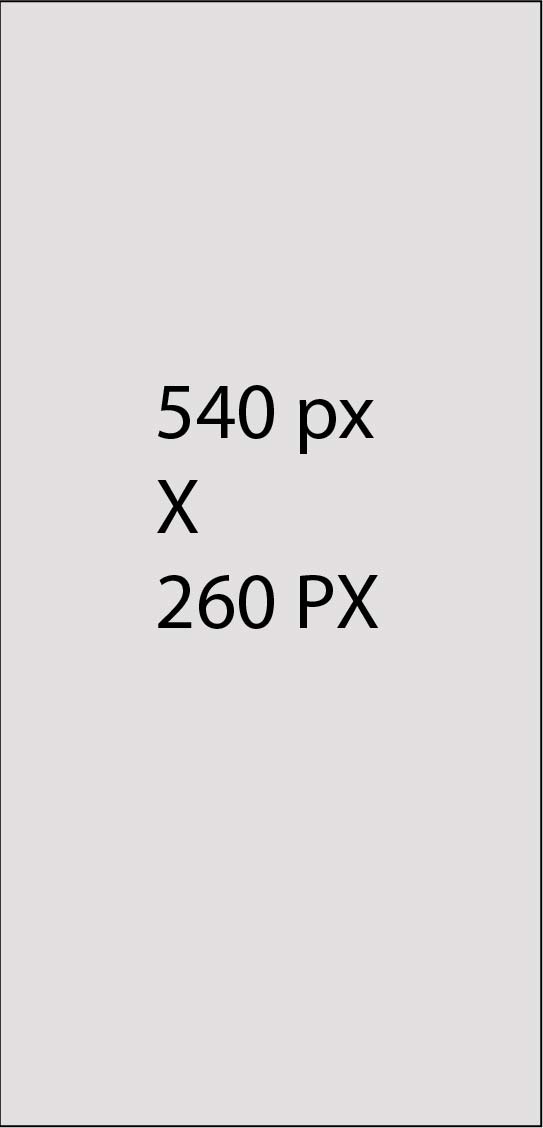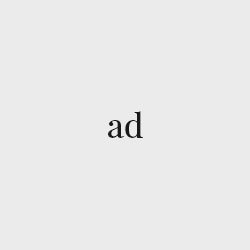Dar El-Hamra est une merveilleuse bâtisse datant de l’occupation ottomane (1516-1830), mais très peu connue du commun des mortels. Il n’a rien à envier aux autres palais et résidences construits durant la même période dans la cité des Beni Mezghenna. Son style architectural est semblable à celui des autres résidences édifiées à la basse Casbah : colonnes en marbre blanc, stucs, boiserie sculptée, faïences de Delft revêtant la partie basse des murs des chambres donnant sur west dar. Sa façade, réaménagée en 1870, est également ornée d’un ruban de faïences de la même origine.
Comme une petite poignée des bâtiments de la basse Casbah, Dar El-Hamra avait échappé de justesse à la démolition. Il avait failli être emporté par l’obstination de certains « bâtisseurs » coloniaux qui voulaient faire, coûte que coûte, de cette partie du Vieil Alger, le quartier européen. Ce qui fut fait d’ailleurs par la suite. La dislocation du quartier s’était poursuivie à la fin des années 1970 et durant les années 1980. La polémique, relayée par la presse de l’époque, s’était installée entre deux groupes d’architectes algériens rassemblant d’un côté des partisans et d’un autre côté des opposants à cette démarche. Des architectes d’une entreprise polonaise ( ?) impliqués dans les destructions du quartier Lallahoum étaient restés à l’écart des houleux débats. L’un d’entre eux, en visite à Alger il y a quelques années, avait fustigé les partisans de ces destructions. Mais, lui et ses compatriotes ne pouvaient intervenir, compte tenu de leur statut de coopérants représentant d’un pays étranger…
La première alerte avait été donnée à la fin du 19e siècle, lorsqu’en 1899, Eugène de Redon, ingénieur en travaux publics, se démenait comme un diable dans le but de « faire table rase » du quartier de la Marine, pour les besoins de la construction d’un quartier moderne, réservé aux Européens. Son projet, qu’il présentait comme allant dans sens de l’embellissement de la ville, prévoyait aussi la démolition des deux dernières mosquées du quartier, djamaa Djedid, de rite hanifi, connue sous le nom de la mosquée de la pêcherie, et djamaa Kébir, la Grande mosquée, édifiée au 10e siècle de notre ère.
La baraka de Sidi Hellal
Au début des années 1930, une décision officielle, encore une, avait été prise pour mettre bas Dar El-Hamra. Le Comité du Vieil Alger, présidé à l’époque par Henri Klein, un des défenseurs de la Casbah d’Alger, avait même organisé, le 25 avril 1937, un dernier pèlerinage et une visite d’adieu à cette superbe bâtisse qui devait, désormais, « subir une mutilation pour le passage d’une voie nouvelle.»
Mais l’ukase, c’est le cas de le dire, n’avait pas été exécuté. Dar El-Hamra avait échappé, encore une fois, aux marteaux des destructeurs. Les ondes positives et la baraka de Sidi-Hellal, dont le mausolée se trouve dans le même quartier Lallahoum, furent peut-être pour quelque chose dans la prolongation de la pérennité de cette admirable bâtisse.
Le mausolée de Sidi Hellal, proche du lycée Emir Abdelkader (ex-Bugeaud), avait été, lui aussi, épargné parce qu’il était inscrit, à l’époque, sur la liste des monuments classés d’Alger.
L’existence de Dar El-Hamra figurait dans un acte datant de 1808/1809. Elle fut réaménagée entre 1816 et 1818 par le dey Hussein qui en est devenu propriétaire. Certains lui attribuait sa construction, alors que d’autres concédait l’édification de la bâtisse au raïs Arnaout Mami (16e siècle), un célèbre corsaire dont le nom est lié à la capture, le 26 septembre 1575, du futur auteur de Don Quichotte de la manche, Miguel de Cervantès de Saavedra, et de son frère Rodrigo. Les deux frères furent faits prisonniers lors de l’attaque conduite par Dali Mami, second d’Arnaout Mami, à Lépante (Grèce), contre la galère Marquesa (Marquise) sur laquelle ils s’y trouvaient.
Ultime rencontre dey Hussein – de Bourmont
Débarqué à Alger le 28 septembre 1575 avec de nombreux autres captifs, Cervantès ne retrouve la liberté que cinq ans plus tard, le 24 octobre 1780. Après le paiement, par sa famille, grâce à une large quête, d’une forte rançon de 500 écus en or à son « propriétaire » ravisseur. Son « séjour » à Alger fut marqué par au moins quatre tentatives d’évasion. Sa cache creusée sous forme d’un tunnel, connue aujourd’hui sous le nom de Grotte de Cervantès, se trouve au Hamma, sur les hauteurs du quartier populaire de Laaqiba, à Belouizdad (ex-Belcourt). Elle mérite de figurer sur les circuits des agences de tourisme locales et étrangères. D’autant qu’elle est située dans le même périmètre le complexe culturel et des loisirs Ryadh El-Feth, de Dar Abdeltif, qui avait fait office de Villa Médicis entre 1907 et 1962, du Musée national des Beaux-Arts et du Jardin d’essai du Hamma.
Après la chute de la Régence ottomane d’Alger, Dar El-Hamra fut attribué au baron Louis-André Pichon, un des premiers intendants civils du corps expéditionnaire français en Algérie, puis successivement à des officiers-directeurs du Génie militaire, qui en avaient fait leur résidence. C’est dans ce palais qu’avait eu lieu, le 8 janvier 1830, l’ultime entrevue entre Hussein, dernier dey déchu d’Alger, et le comte de Bourmont. Elle s’était déroulée quatre jours après la reddition du représentant de la Sublime Porte et deux jours avant son embarquement avec sa smala, le 10 juillet 1830, à bord du navire Jeanne d’Arc qui les conduisit vers Naples.
Classé monument historique en 1887, Dar El-Hamra, séparé de la mosquée Ali Bitchin par la rue Bab El-oued, avait subi maints réaménagements depuis 1830. Cependant, sa structure architecturale primitive ne semble pas avoir été trop abîmée, du moins dans sa partie intérieure. Les murs extérieurs ont subi des retouches, visibles à l’œil nu.
Dar El-Hamra abrite des services du Centre national de recherche en archéologie (CNRA) et, dans un terrain attenant à la bâtisse, quelques vestiges.
M. A. H.